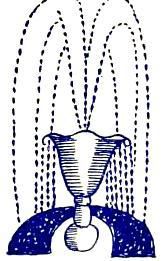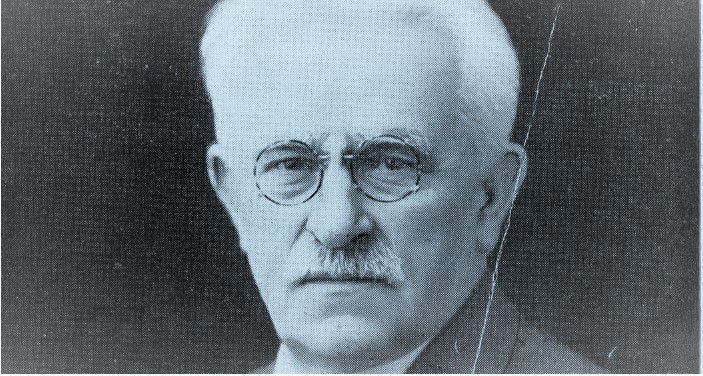|
green | ||
L'orgue éclate dans la rue Du village d'Otterton. La machine tonitrue Fausse au moins d'un double ton. Ce n'est pas l'humble détresse De nos petits orgues bas. C'est une ardente allégresse Qui tourbillonne et s'ébat. Tzing, tzing ! Vive la musique ! Ça vous saisit à la peau. Tantôt l'hymne britannique Qui soulève les chapeaux, Tantôt le song de la veille, Succès de Gertie Millar Et les groupes s'émerveillent De cet orchestre braillard Qui, sur la rose des dalles Du village d'Otterton Bâtit une succursale Au paradis de Milton. | ||
rené kerdyk (1885-1945). Mercure de France. (août 1913). | ||
ariette de guerre | ||
Je songe à vous, rayons chargés De mes fins livres reliés, 0 chers bouquins qui consoliez Mes longs nocturnes affligés, A vous les files principales Des classiques de bonne marque, La robe mauve d’Andromaque Et les pâle Provinciales, Et toi, multiple intermezzo; Tout tiède encore de mes mains, Livres jaunes, Régnier, Samain, Et notre Verlaine si haut, Si haut dans la chaleur des lampes, Parmi les roses balancées, Et les caresses tôt passées, Et les distants gestes d'estampes… Et je songe à disposer pour Vous, Despax, Hourcade, Drouet, Et nos moindres frères tués Un coin choisi de tendre amour Où peut-être un soir une femme Mettra, avec des doigts qui tremblent, Ces vers, afin qu'on dorme ensemble Très doucement, serrant nos âmes. | ||
rené kerdyk (1885-1945). Mercure de France. (mars 1917). | ||
intime | ||
Les lettres sur le bureau Semblent exhaler des plaintes Et la courte horloge peinte Fait des poids comme un vieux beau. L'inutile plume d'oie Et le bloc de pâle azur Dévotement dorment sur L'album de Ma Mère l'Oye. Sous les verres les images Disent des enfantillages Et les parents dans leurs cadres Sont bien sages pour leur âge. Le buvard aux bavardages Rose comme un écolier Attend l'heure de lier Sa bouche aux lèvres des phrases Tandis qu’au loin mes pigeons Roucoulent des gargarismes Et font un Henri Matisse Avec l'ombre du balcon... | ||
rené kerdyk (1885-1945). Nouvelle Revue française (septembre 1921). | ||
|