| Alexandre le bienveillant |  |
|
La Revue Critique des idées et des livres |
| "Ce n’est pas seulement pour vivre ensemble, mais pour bien vivre ensemble qu’on forme un État." aristote |
|
Politique | International | Société | Idées | Histoire | Arts | Littérature | Revue des revues
|
| Alexandre le bienveillant |  |
| Portrait Une nouvelle d'Alain-Fournier |  |
[1]. Il s'agit d'Yvonne de Quiévrecourt, que Fournier croisera dans un éclair le jeudi de l'Ascension et qu'il rencontrera plus longuement le dimanche de la Pentecôte 1905. Elle sera "l'aventure capitale de sa vie" et lui inspirera le personnage d'Yvonne de Galais du Grand Meaulnes.
|
Le retour du
Major Thompson |
 |
On ne félicite jamais assez les éditeurs qui font œuvre utile. C’est le cas de Bernard de Fallois qui a eu la belle idée de rééditer une douzaine de titres de Pierre Daninos [1], parmi lesquels les fameux Carnets du major Thompson. Voilà une livraison propre à égayer nos longues soirées d’hiver et qui va nous permettre de retrouver, le sourire aux lèvres, le charme tranquille des années cinquante et soixante. Ah ! Le Major ! Sa disparition en 2005, en même temps que celle de son père spirituel, a créé bien des équivoques. Elle a pu laisser penser à certains que nous avions changé d’ère géologique. On nous annonçait un monde où les Anglais ne seraient plus anglais, les Français moins français que nature et les Allemands presque civilisés. On nous parlait d’une Europe sans frontière et sans différences, où les vestes de tweed, les rosettes de la légion d’honneur, les culottes de peau et autres signes distinctifs ne seraient plus que de lointains souvenirs. Tout devait se dissoudre dans la mélasse mondialisée et dans le waterzoi bruxellois. Et puis finalement non, rien ne s’est passé comme on nous le prédisait. L’Angleterre, malgré le Tunnel sous la Manche, continue de rouler à gauche. La livre sterling est plus solide que jamais et la reine Elisabeth, toujours fidèle au poste, vient de recevoir, à l’occasion de son jubilé, l’hommage de millions de braves gens du Royaume-Uni et du Commonwealth. L’Allemagne est toujours en guerre avec le reste de l’Europe et une nouvelle walkyrie, blonde et grassouillette, veille sur la destinée de nos voisins d’outre-rhin. Quant à la France, selon un scénario rodé depuis plus de deux cent ans, elle vient de troquer une équipe de républicains médiocres contre une autre équipe de républicains, tout aussi médiocres, ce qui ne l’empêchera pas de vivre. L’ordre des choses étant respecté, il était naturel que le Major Thompson envisage un jour ou l’autre de faire son retour parmi nous. Nous l’attendions. Le voici.
Les moustaches, le melon, la pipe, la silhouette sportive de l’honorable William Marmaduke Thompson nous sont devenus si familiers qu’on en oublierait presque comment il est entré dans notre univers. Comme les meilleurs choses, il est le fruit du hasard et de la nécessité. Nous sommes en 1954 et Pierre Brisson, alors directeur du Figaro, doit faire face à une offensive de son concurrent l’Aurore qui annonce une grande série d’articles signés Jules Romains [2]. Il faut trouver rapidement la réplique. Brisson imagine une chronique de bonne tenue littéraire, mais qui accroche, passionne et amuse le lecteur. Il fait appel à Daninos, un esprit vif et plein d’humour. Le thème est assez vite trouvé : une satire amusante des mœurs françaises. Daninos ne prend pas de grands risques car il sait que l’autodérision est un de nos sports préférés. Là où il se montre un peu plus aventureux c’est en confiant à un Anglais, personnage inventé de toute pièce, le soin de nous faire la morale. Le Major Thompson est né. Daninos se fait passer pour son traducteur, ce qui lui permet d’intervenir dans les débats par des notes de bas de page, où il se moque à son tour des usages de nos amis d’outre-manche. De ce dialogue du Major et de son traducteur nait une œuvre savoureuse où les deux nations se renvoient la balle, se disputent joyeusement, s’attendrissent mutuellement sur leur passé glorieux ou sur leurs petits travers. Comme les Français sont persuadés que le reste de l’univers a les yeux rivés sur eux, et que les Anglais pensent à peu près la même chose sur leur propre compte, on ne s’étonnera pas que les Carnets du major Thompson aient fait le tour du monde. Traduits dans vingt-huit pays, commentés dans les meilleurs universités, voilà un beau succès pour ce qui ne devait être qu’un simple coup de presse.
Nous laisserons nos lecteurs se plonger avec délice dans la myriade d’anecdotes, de dialogues, de choses vues qui émaillent ces Carnets. Tout ce qui distingue les Français du reste du monde y passe ou presque : notre méfiance de paysan lorsqu’il s’agit d’argent, notre crédulité toute démocratique lorsqu’il est question de politique, notre goût pour la bureaucratie, les étiquettes et les subdivisions, notre inhospitalité légendaire, notre aversion pour les langues ou les coutumes des autres, notre cuisine magnifique, notre parfaite mauvaise foi au volant, face aux étrangers et dans les mille moments de la vie quotidienne… En contrepoint, l’Angleterre du Major parait plus sérieuse, plus terre à terre, moins rouspéteuse et un peu plus ennuyeuse. Des comparaisons entre les deux peuples, on savourera tout particulièrement les passages concernant l’histoire, l’éducation et les institutions.
En histoire, le Major fait montre d’un parti-pris scandaleux : l’épopée napoléonienne se résume évidemment à Waterloo, Trafalgar et au Bellérophon en route vers Sainte Hélène ; Wellington et Nelson, héros largement surfaits, y tiennent toute la place ; à peine quelques mots d’excuse pour le supplice de Jeanne d’Arc que l’hypocrisie anglaise continue à mettre sur le dos de ses juges français ; quant à la guerre de Cent ans, les chevaliers français, empêtrés dans leurs cuirasses, y ont évidemment le mauvais rôle face à la (déjà) fameuse « flexibilité » anglaise. Est-ce parce qu’un scrupule finit par l’étouffer que le Major se laisse aller, pour quelques instants seulement, à un moment de tendresse franco-britannique ? « Surtout en hiver, à la tombée du jour, il m’arrive encore de penser à la guerre de Cent ans et à ces noms – Crécy, Poitiers, Azincourt – qui dans un collège du Dorset résonnent comme des cris de triomphe tandis qu’à vingt lieues de là, dans un lycée normand, ils sonnent le glas de la chevalerie française. Alors, tandis que tombe le crépuscule et que cinquante fiers petits écoliers anglais sentent couler dans leurs veines le sang du Prince Noir, la tristesse emplit le cœur de cinquante fiers petits Français qui voient Jean le Bon (mais imprudent) emmené en captivité en Angleterre. »
Touchante sollicitude ! Et qui devrait nous valoir logiquement les mêmes prévenances lorsque ces mêmes cinquante fiers petits Français font résonner comme des cris de triomphe les noms de Hastings, de Bouvines, de Patay, d’Orléans, de Formigny, de Castillon, de Fleurus, de Yorktown et de quelques autres lieux et qu’ils sentent couler dans leurs veines le sang de Jean d’Aulon, du maréchal de Luxembourg ou de l’amiral de Grave ! Mais de tout cela, curieusement, le Major ne souffle pas un mot !
L’éducation, cette marque de civilisation qui unit, partout dans le monde, les esprits et les cœurs est elle aussi une source de conflits entre Français et Anglais. Le Major en fait l’expérience à ses dépens : marié à une française, il ressent dans sa chair le drame d’une progéniture binationale, ballottée chaotiquement entre la rude discipline des collèges anglais et la vie libérale et paresseuse des institutions françaises. Après des années de conflit, le couple Thompson finit par résoudre l’affaire de la façon la plus simple qui soit : ils mettent leurs charmantes têtes blondes en Suisse, « ce merveilleux petit pays qui sait toujours tirer des guerres, intestines ou extérieures, le plus sage parti ». Rien de tel en effet que les collèges suisses pour faire de vrais européens des rejetons partagés de Molière et de Shakespeare.
Reste la politique. Voilà assurément un domaine où les Anglais ont des avantages sur nous. Des institutions populaires, bonifiées par l’Histoire et d’une stabilité à toute épreuve. Une monarchie à la hauteur de sa tâche, libérale, bon enfant, presque invisible, lorsque le pays va bien, farouche, guerrière, prévoyante et organisée, lorsque les frontières du Royaume ou de l’Empire sont menacées. En un mot, le contraire de la République française ! Comment le Français, si cartésien, peut-il accepter de vivre sous un régime qui défit tous les jours les lois de la raison et qui choisit systématiquement ses dirigeants parmi les plus bêtes ou, à défaut, parmi les plus menteurs ? Le Major, bon connaisseur de nos mœurs politiques, a sa petite idée sur le sujet. En réalité, si les Français n’aiment rien tant que la « ligne claire » en art ou en littérature, ils adorent vivre dans la contradiction en politique. « Ces conservateurs, qui, depuis deux cents ans, ne cessent de glisser vers la gauche jusqu’à y retrouver leur droite, ces républicains qui font depuis plus d’un siècle du refoulement de royauté et apprennent à leurs enfants, avec des larmes dans la voix, l’histoire des rois qui, en mille ans, firent la France – quel damné observateur oserait les définir d’un trait, si ce n’est par la contradiction ».
Notre Anglais y rajoute un autre trait de caractère politique que la plupart d’entre nous ne renieraient pas : le scepticisme, un scepticisme à toute épreuve à l’égard des hommes qui nous dirigent et des idées qui les guident. Qui n’a pas remarqué, parmi les plus républicains d’entre nous, cette ironie, ce sourire aux lèvres, lorsqu’un de nos hommes politiques termine son discours en rappelant les grands principes de 89 ? « - Vous y croyez, vous ? Pfuitt ! … Des mots ! … Toujours des mots ! » « Envahi, occupé, opprimé, brimé, traînant derrière lui le spleen de 1900 et du franc-or, le Français est un monsieur qui ne croit à rien, parce que, à son avis, il ne sert plus à rien de croire à quelque chose ». Il nous arrive bien, de temps à autre, de considérer que les bornes sont dépassées, que l’incompétence, l’imbécilité du régime ont atteint leurs limites. C’est le moment, comme le remarque le Major, où, autour de nous, un monsieur, d’ordinaire décoré, s’écrit : « Ce qu’il nous faudrait, c’est un homme à poigne, qui fasse un peu d’ordre là-dedans, un bon coup de balai ! », ce qui suffit généralement pour provoquer le mouvement inverse. « Qu’un homme à poigne se signale à l’horizon, qu’il parle de réformer les institutions parlementaires, de mettre de l’ordre, de faire régner la discipline et, pour un satisfait, voilà mille mécontents. On crie au scélérat. On stigmatise la trahison. On veut égorger la République : ils ne passeront pas » et l’on finit par en appeler aux principes de 89 dont on se gaussait à l’instant. Incorrigibles, les Français ? A croire que depuis deux siècles ils sont bien mal gouvernés !
Signalons pour terminer les suites que Daninos donna aux aventures de son Major. Les Editions de Fallois, décidemment pleines de prévenance pour leurs lecteurs, ont eu la bonne idée de les rééditer avec ces Carnets. Dans la première – Le secret du Major Thompson -, on retrouve l’excellent Marmaduke au cœur d’une Amérique qui n’a rien à nous envier en matière d’étrangetés. La seconde – Le Major tricolore – nous emmène dans la France des années de Gaulle et l’on y découvre que si notre Anglais a un petit faible pour le Général, il a peu d’indulgence pour mai 68. Quand aux Derniers Carnets du Major, publiés en 2000, ils concluent sur un ton nostalgique un siècle de chamailleries franco-anglaises, en tapant à bras raccourcis sur les ridicules de la bourgeoisie bohème qui occupent les deux rives de la Manche. C’est drôle, bien vu, réactionnaire à souhait et en même temps plein d’espoir pour l’avenir. Good heavens ! aurait dit le Major, Pourquoi voudriez vous que nous soyons tristes ? Les Anglais ne sont-ils pas définitivement anglais, les Français définitivement imprévisibles et les Allemands définitivement butors ? Et ceux qui nous prédisaient le contraire ne sont-ils pas, à cette heure, en train de cuire à petit feu dans le chaudron infernal de l’euro ? Too bad for them! Quel Trafalgar que leur Europe, old boy ! Même votre Napoléon ne se serait pas laisser embringuer dans un pareil désastre !
Eugène Charles.
[1]. Pierre Daninos, Les Carnets du Major Thompson et autre titres, préfacés par Etienne de Montety. (Editions de Fallois, avril 2012). - Pierre Daninos, Snobissimo et autre titres, préfacés par Philippe Meyer (Editions de Fallois, avril 2012).
[2]. Cette époque où la grande presse se faisait concurrence à coup d’articles de Jules Romains, d’André Malraux, d’André Gide ou de François Mauriac peut laisser rêveur, à l’heure où les piliers de notre vie médiatique s’appellent Les Inrocks, Libération, Le Figaro Magazine ou Télérama ! C’est à ces petits détails que l’on mesure combien le monde a progressé depuis un demi-siècle…
| Eloge des forêts |  |
Quel beau livre que celui de M. Sylvain Tesson ! On n’est plus tout à fait le même après la lecture de ses Forêts de Sibérie [1]. On en sort regonflé, ragaillardi, presque réconcilié avec le monde. Nous suivions depuis quelques temps ce jeune auteur du coin de l’œil. Nous avions aimé ses premiers livres, son Axe du loup, son charmant Petit traité sur l’immensité du monde. Il avait publié il y a deux ans un recueil de nouvelles – Une vie à coucher dehors – qui manifestait déjà une belle maturité d’écriture et un sens du récit peu commun. Mais son journal sibérien est d’une espèce supérieure, c’est une sorte de petit chef d’œuvre à mettre à côté des meilleurs récits de retranchement, de solitude et d’ermitage. On pense à Jünger, à Stevenson, à Stendhal lorsqu’il n’est pas trop bavard, souvent aussi à notre Giono.
Entendons-nous bien : M. Tesson n’a rien d’un herboriste, ni d’un promeneur, ni d’un touriste. Son départ pour le désert ne s’est pas fait sur un coup de tête et il ne faut y voir aucun prétexte à littérature. C’est d’abord un pari, l’un de ces paris réfléchis qu’on se lance à soi-même lorsqu’on s’aperçoit soudain qu’on est au mitan de la vie : « Je m’étais promis avant mes quarante ans de vivre en ermite au fond des bois ». Certains remâchent ce genre de défi toute leur existence, ils se voient l’an prochain à Jérusalem, s’imaginent l’année suivante à Marienbad mais ne quittent jamais leur deux pièces-cuisine. Pas Sylvain Tesson. Aussitôt dit, aussitôt fait, ses malles prêtes, il attrape le premier vol pour Irkoutsk, fonce en camion sur des étendues gelées pour prendre possession d’une cabane sibérienne au bord du Lac Baïkal. « Un village à cent vingt kilomètres, pas de voisins, pas de route d’accès, parfois une visite. L’hiver des températures de -30°C, l’été des ours sur les berges. Bref, le paradis ». Robinson, parlant de son île, n’aurait pas mieux dit.
Vivre en solitaire n’est ni un jeu, ni une aventure. L’imprévu n’y est pas admis. Il y faut de la discipline et une bonne dose d’humilité. Un certain goût du confort aussi. On s’y lève de bonne heure. On passe ses journées à casser la glace, à couper du bois, à pêcher, à se nourrir et à entretenir sa cabane. On y dort beaucoup, aussi. Les livres, les cigares et la vodka sont les ingrédients indispensables d’une existence où le froid, la neige envahissante, le vent immense, vous forcent souvent à rester entre quatre murs. M. Tesson n’a rien laissé au hasard : les ouvrages qui vont colorer, saison après saison, sa solitude ont été choisis avec le plus grand soin : « J’ai Michel Tournier pour la songerie, Michel Déon pour la mélancolie, Lawrence pour la sensualité, Mishima pour les froids d’acier, Daniel Defoe pour le mythe », Giono, Jünger bien sûr, l’indispensable Vie de Rancé de Chateaubriand, quelques philosophes, Lao-tseu, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, les stoïciens. Voilà, comme le dit plaisamment M. Tesson, pour combler la pauvreté de sa vie intérieure !
Dans ce paradis du bout du monde, si le travail ne manque pas, les distractions sont rares. Peu d’animaux, très peu d’hommes. Un lynx, quelques ours dont on relève par instant les traces dans la neige. Un ou deux couples de forestiers, commis à la garde d’immensités neigeuses, et qui viennent, de temps à autre, partager la vodka et l’ordinaire de l’auteur. On évoque les rumeurs qui remontent, déformées, de la civilisation, on échange des nouvelles, on s’enivre et on se quitte au plus vite. Le monde du Baïkal retrouve presque immédiatement sa fixité, sa beauté écrasante, la solitude reprend ses droits et la vie se partage à nouveau entre ses deux pôles, la cabane chaude et maternelle, le lac, nappe liquide, puissante, froide et paternelle.
C’est là, entre ces deux points fixes, la cabane et le lac, que M. Tesson va pratiquer son ascèse. L’existence, réduite à l’essentiel, c’est à dire à l’utile et au fécond, se libère de ses pesanteurs. Elle se déleste et se fait progressivement plus libre et plus heureuse. « Habiter joyeusement des clairières sauvages vaut mieux que dépérir en ville », prophétise notre ermite qui n’est dupe ni des plaisirs faciles de la société de consommation, ni du contre discours alternatif ou écologiste qui empeste la fausse morale et le ressentiment. Le rebelle appointé qui s’exprime à la télévision ne vaut pas plus cher que le yuppie festif. Ils sont les deux faces d’un même monde, sordide, sinistre, minéral. L’ermite, lui, n’acquiesce ni ne s’oppose. « Il ne menace pas la société des hommes. (…) Il ressemble au convive qui, d’un geste doux, refuse le plat. (…) Il ne dénonce pas un mensonge, il cherche une vérité. » La solitude agit en profondeur, elle favorise les gestations, les métamorphoses. C’est le même être, non un autre mais meilleur, plus fort, plus libre qu’elle rend à la société des hommes. Après six mois, Sylvain Tesson quittera sa taïga. A son arrivée au désert, il avait trouvé l’air glacé de l’hiver, les épreuves du grand froid, les doutes affreux, le désespoir et les larmes. Il repartira avec l’été, paisible, maître de son temps, homme neuf, délivré des chimères et des amours anciennes, délesté à jamais du sublime mais stérile cocon de la jeunesse.
« Le luxe de l’ermite, c’est la beauté », nous confie M. Tesson. Il fait mieux que l’affirmer. Il l’exprime dans des pages somptueuses où le cycle de la nature, le rythme des saisons, l’harmonie du monde sont mis en scène dans une très belle langue. Comme dans ce passage où « la lune rousse est montée dans la nuit. Son reflet dans les éclats de la banquise : une hostie de sang sur l’autel blessé ». Ou dans cet autre encore : « Le soleil de 6 heures a transformé les marais en pièces d’eau de forêt arthurienne. Une vapeur de légende ouate la surface, y ménage des trouées où se fichent mille diffractions. Spectacle pour écrivain gothique victorien. Dans un monde fantastique de la fin du XIXe siècle, les libellules deviendraient les montures ailées de fées, les scintillements de la lumière sur l’eau seraient les baisers des ondines, les brumes l’haleine des sylphes, les araignées revêtiraient le statut de gardiennes des portes du vent, les eaux dormantes abriteraient le caveau d’un dieu tutélaire, et les coulées de soleil, immiscées entre les crêts, symboliseraient la voie pavée d’or vers le royaume du Ciel. Mais nous ne sommes que des hommes dans un monde d’atomes. Il faut rentrer avant la nuit. ». A cette débauche de nature, nous préférons toutefois d’autres images, plus fortes et peut-être plus belles encore : celles de ces matins de froid sec, ensoleillés, où Sylvain Tesson patine, ivre de joie, sur son lac engourdi. Ces matins-là, Nietzsche et son dieu qui danse ne sont pas très loin de lui.
Eugène Charles.
[1]. Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie (Gallimard, 2011). L'ouvrage a reçu le Prix Médicis essai en 2011.
| S'engager ? | |
« Venez donc vendredi à 17 heures, chez moi, écrit Albert Camus. Et n’y mettez pas tant de façons, je ne suis pas Greta Garbo. » – C’est la phrase qui ouvre la correspondance entre l’auteur de L’Eté et Michel Vinaver ; et cette remarque pince-sans-rire n’est pas celle d’un faux modeste, c’est celle d’un homme simple, qui dépassionne la célébrité internationale qui lui est tombée dessus sans crier gare : les lettres que Camus échangera avec Michel Vinaver témoigneront jusqu’au bout de cette simplicité, et de l’attention qu’il porte aux autres.
*
Nous sommes en 1946, aux États-Unis, où Albert Camus fait une conférence et Michel Grinberg des études. Le premier,qui signera bientôt Vinavert, puis Vinaver, aborde le second, que Le Mythe de Sisyphe et L’Etranger ont rendu célèbre. – C’est le temps des Maîtres, et Camus est de ceux-là, avec Sartre, Malraux et quelques autres, dont la jeunesse recherche les conseils, sinon l’autorité : la vie n’a pas de sens, Dieu est mort, il reste la littérature qui fournit des alibis à l’absurdité d’exister.
Vinaver a dix-neuf ans, et c’est un âge très sérieux (d’autant plus sérieux que l’époque est elle-même très sérieuse : l’intellectuel engagé et le roman à thèse commencent leur pénible règne), où l’on dit avec des mines de pasteur méthodiste les choses les plus définitives, ou les plus baroques (« Seule peut-être l’URSS possède la candeur homérique nécessaire pour la genèse d’un poème épique ») ; et en effet, d’emblée, on sent que l’étudiant n’est pas là pour rigoler : le 15 novembre 1946, il envoie à Camus une longue lettre dont Simon Chemama, qui a annoté le recueil, nous apprend qu’elle est « une synthèse étonnante de George Thomson, de Simone Weil » et de Camus lui-même.
« Chaque homme doit, dit-on, “s’engager”, écrit le jeune intellectuel dans cette lettre. Le seul engagement qui ait pour moi quelque signification c’est celui qui consiste à faire prendre aux hommes la conscience de leur situation. » Bien entendu, c’est aux livres que revient cette tâche, à condition que leur auteur échappe au didactisme ; or c’est bientôt le reproche que Vinaver adressera à certaines œuvres de Camus.
*
Vinaver a vu Les Justes, et il dit en avoir éprouvé une impression de « décalage » : « Je sais bien que vous avez essayé de montrer comment le meurtre abstrait qui nous caractérise est déjà en herbe dans l’évènement que vous traitez (...). Mais c’est une déduction intellectuelle, dramatiquement peu convaincante sinon pas du tout : il y a pour le spectateur si nettement une différence de nature entre la chose que vous présentez et la réalité qu’il vit, qu’il ne fait pas le lien ».
Davantage, cette pièce n’a même pas la valeur d’une « chronique historique » : « le dialogue a un ton qui ressemble à celui de l’éternité » ; c’est finalement une pièce « nostalgique », qui reflète un temps où l’on pouvait encore « situer tel problème entre tel et tel pôle de la conscience », alors que l’époque voudrait que l’on parlât du « chaos », du « vide au sein de chaque conscience ». Conséquemment, la pièce est « sereine », et non « tourmentée » : « la souffrance de chaque individu est secondaire au fait qu’on sent [les personnages], du début à la fin, en situation de salut. »
Mais Vinaver ne s’en tient pas là ; cherchant les causes de l’échec fondamental – littéraire, théâtral, esthétique – des Justes, il les trouve dans la nasse de la célébrité où Camus s’est trouvé pris, soudainement, au sortir de la seconde guerre mondiale : elle n’a pas seulement fait de lui un écrivain connu, elle en a fait un guide – un « phare », écrit Vinaver.
Ainsi, « vous vous êtes demandé si vous n’aviez pas, vis-à-vis des hommes qui se dirigeaient vers vous, une responsabilité. Vous avez cessé de crier n’importe quoi. » Et tout le problème est là : « Je voudrais, de nouveau, vous entendre crier “n’importe quoi”, sans vous préoccuper d’autre chose que de ce “n’importe quoi”. »
*
La réaction de Camus est à la hauteur de ce que nous connaissons de lui. (Ce qu’il y a de plus frappant, et de plus touchant, dans ces lettres, c’est Camus lui-même, qui confirme ce que nous savions de sa simplicité, aussi naturelle que sa phrase ; de son absence de dogmatisme, au milieu d’opinions affermies ; de son humilité, maintenue dans sa gloire retentissante ; de sa bienveillance à l’égard d’un débutant qui ne le ménage pas ; et de sa disponibilité, lorsque le jeune auteur cherche du travail – finalement, sans l’aide du maître, il en trouvera dans le rasoir [1] –, puis un lecteur et un éditeur pour ses romans – Lataume sera publié en 1950 et L’Objecteur en 1951.)
La réaction de Camus aux commentaires de Vinaver est donc à la hauteur de ce que nous savions du futur prix Nobel : il donne largement raison à son correspondant. Ce devoir, cette responsabilité qu’il se sent, et qui l’encorde, il l’appelle même une crise. Or « la crise est finie », car, dès qu’il aura publié quelques livres qui correspondent encore à ce rôle qu’il perçoit qu’il doit jouer, il n’écrira plus qu’« au hasard », ce hasard que Vinaver appelle le « n’importe quoi ». (Dans ses Carnets, Camus resserrera en deux phrases cette tension entre devoir et hasard : « L’écrivain est finalement responsable de ce qu’il fait envers la société. Mais il lui faut accepter (et c’est là qu’il doit se montrer très modeste, très peu exigeant), de ne pas connaître d’avance sa responsabilité, d’ignorer, tant qu’il écrit, les conditions de son engagement – de prendre un risque. »)
Cette voie nouvelle, l’auteur de Noces n’aura pas le loisir de la creuser : un autre hasard l’attend, le cherche, et le trouvera dans une Facel-Vega lancée contre un arbre. – Dès lors, et c’est la thèse que défend Simon Chemama dans sa préface, peut-être Vinaver a-t-il « écrit le théâtre de Camus, le théâtre que Camus n’a pas voulu ou n’a pas su écrire » ; à moins qu’il n’en ait pas eu le temps.
*
C’était le temps des Maîtres, nous l’avons dit, et Camus était de ceux-là ; et ce temps, et Camus, sont morts. Adolescents, nous n’en avions pas conscience : nous vivions encore parmi eux, dont nous vénérions les ombres, car nous n’avions pas consommé toute gratitude ; ou, pour le dire avec les mots de Mauriac, nous bercions encore dans leurs tombeaux ces morts bien-aimés [2].
Nos professeurs nous y aidaient qui nous apprenaient que l’absurdité moderne commençait avec un indifférent qui ne savait pas le jour exact de la mort de sa mère, que le suicide était le seul problème philosophique vraiment sérieux, que Meursault annonçait Robbe-Grillet comme « Misère de la Kabylie » la littérature engagée, et qu’entre la justice des poseurs de bombes et sa mère il valait mieux choisir sa mère.
Certes, Camus était mort, et Bernanos avant lui, et Mauriac après eux, mais ils étaient vivants pour nous ; et puis, d’autres viendraient bientôt. Certes, ceux qui étaient venus, notamment dans les années soixante-dix, nous assommaient, mais nous les regardions comme une parenthèse.
Ils ne furent pas une parenthèse. La figure du grand écrivain français qui nous en imposait, que nous pensions éternelle comme la littérature, est morte depuis longtemps, et toute gratitude est désormais consommée. – C’est aussi un des intérêts de ces lettres : nous ramener au temps où un jeune homme cherchait auprès d’un Maître des raisons d’admirer.
Bruno Lafourcade.
[1] A partir de 1953, Vinaver sera employé par la société Gillette, où il fera carrière. – En 1955, l’auteur des Coréens écrivait d’ailleurs à Camus qu’il continuait de lier sa vie « aux lames de rasoir ». « Arrachez donc aux rasoirs le temps d’un livre », lui répondait son correspondant.
[2] « Ceux qui l’ont lue n’ont pas oublié cette phrase de Beauvoir : “Le tombeau de Chateaubriand nous sembla si ridiculement pompeux dans sa fausse simplicité que pour marquer son mépris, Sartre pissa dessus.’’ Dans cette volonté d’avilir, où il entre une pompe autrement ostensible, et autrement ridicule, c’est un monde nouveau qui naît, celui où l’on conchie les maîtres, avec leur nom et leur mort. Et c’est un Mauriac, désorienté et atterré par ce geste, qui ajoute dans son Bloc-notes : “Et nous, nous bercions dans leurs tombeaux ces morts bien-aimés... ’’ » (Bruno Lafourcade, Derniers feux, Conseils à un jeune écrivain, Editions de la Fontaine Secrète, 2012).
| Un petit mufle irréaliste |  |
| Pour saluer Félicien Marceau | 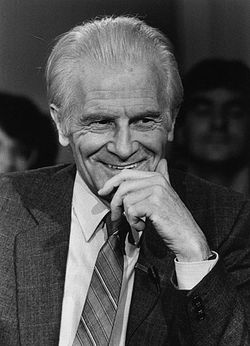 |
Eugène Charles.
[1]. On lira avec beaucoup de plaisir le roman de jeunesse de Félicien Marceau, les Pacifiques, que l'excellente maison De Fallois vient de rééditer, et qui retrace, dans un style plein d'ironie et de légèreté, ces journées de juin 39 à mai 40 et les illusions d'une génération qui allait payer cher le prix de la guerre et celui de la liberté.
| Combat avec l'Ange |  |
La dernière livraison matznévienne est un recueil de chroniques qui nous ramène aux bienheureuses années soixante[1]. Matzneff fait ses premières armes à Combat, et Henri Smadja et Philippe Tesson ne sont pas peu fiers de leur jeune recrue. A vingt-six ans, il donne chaque jeudi une chronique, publiée en une, où il piétine allègrement les fausses valeurs et étrille les grands de ce monde. Henry Chapier, qui dirige alors les pages artistiques de Combat, lui propose de tenir également une chronique du petit écran où il pourra pourfendre plus commodément encore "le confort intellectuel, les sorcières et les loups-garous". Ce sera La Séquence de Gabriel Matzneff, par référence à la fameuse Séquence du spectateur. L'expérience durera deux ans, jusqu'à cette présidentielle de 1965 qui verra l'échec de François Mitterrand - que Matzneff soutient par amitié - et la victoire du Commandeur. Le chroniqueur, fatigué des joutes médiatiques, songe alors à d'autres horizons. Montherlant le houspille : "Vous êtes un écrivain, ne vous laissez pas bouffer par le journalisme. Vous devez rompre avec l'actualité, prendre le large, vous plonger dans l'écriture de votre roman." Il file à Tunis et y boucle l'Archimandrite. Sa dernière chronique de télévision, datée de février 1966, marque son adieu au journalisme.
Matzneff est au mieux de sa forme dans ces chroniques, virulent, drôle, impertinent. Sa Séquence est l'occasion de parler de tout, de politique, de moeurs, de religion, de littérature, tout autant que de télévision. Le petit écran n'est qu'un prétexte. Dès le premier billet, notre chroniqueur s'en excuse auprès de son public: il n'a quasiment jamais regardé la télévision, il n'a ni téléviseur, ni l'envie d'en acheter un et l'univers de la rue Cognac-Jay lui est à peu près inconnu. Qu'à cela ne tienne ! Les chroniques tombent, très régulièrement, les unes derrière les autres - plus de cinq cent au total - pour la plus grande joie des lecteurs de Combat. Le thème de départ a généralement peu d'importance. C'est parfois une émission, parfois un débat, parfois l'intervention intempestive d'un ministre au beau milieu d'une soirée prometteuse, parfois le récit des intrigues picrocholines qui agitent déjà le petit monde de l'audiovisuel. Matzneff fustige, il dénonce, mais pas seulement. Il fait aussi campagne : pour la liberté d'expression, contre le mensonge et le bourrage de crâne, pour la pluralité religieuse à la télévision... Il arrive que sa Séquence prenne des airs de leçon de philosophie où Nietzsche, Spinoza, Lucrèce et Schopenhauer confèrent gravement sur les dangers du petit écran!
Sa première cible, c'est la télévision aux ordres. Celle de l'époque n'est plus brillante que celle d'aujourd'hui et les politiciens s'y conduisent aussi mal. Elle donne des ailes à Matzneff qui n'y va pas de main morte. Un véritable festival d'insolences. Il y a les têtes de turcs de haut vol à qui il réserve ses meilleures formules: Pompidou, Giscard, le ministre de l'intérieur Roger Frey, "tout droit sorti d'un film d'épouvante", celui de l'éducation Christian Fouchet, "une face de gorgone ministérielle et policière", Alain Peyrefitte, "le marsupilami de l'information", sans compter le mirobolant Wladimir d'Ormesson, passé, par le truchement du Figaro, de Vichy au Général et qui préside alors aux destinées de l'ORTF. Il y a aussi toute une basse-cour régimiste et médiatique, beaucoup plus malpropre, qui est traitée avec davantage de rudesse. Certains ont droit à un régime de faveur: Claude Contamine, le grassouillet directeur de l'ORTF, est brocardé à longueur de pages; Léon Zitrone, éternel perroquet des pouvoirs en place, est conspué dès qu'il apparait sur l'écran; Edouard Sablier et Jean Benedetti, les duettistes du journal télévisé, sont promis aux pires supplices, en cas de changement de régime : "ils seront empaillés et exposés à la Maison de la Radio", nous dit Matzneff. "il est vrai qu'empaillés, ils le sont déjà. Traitées chimiquement, leurs peaux pourraient faire d'excellentes carpettes". On ne peut pas s'empêcher de penser à leurs modernes successeurs qu'on accomoderais volontiers de la même façon !
Si la polémique donne le teint frais à Matzneff, la contemplation des programmes de télévision le pousse à l'introspection et à la philosophie. Il a cru, comme beaucoup d'autres, que "la raison d'être du petit écran" était "d'éduquer le public, de l'instruire". Pour déchanter très vite. "La télévision est l'expression la plus poussée du mal qui, tel un cancer, ronge le monde moderne: la culture générale. Rien n'est plus fatal à l'aristocratie de l'esprit, à la haute vie de l'âme, que cette rage de toucher à tout, de toucher un peu de tout, d'être informé de tout. La culture que dispense la télévision ressemble au faux brillant de ces gens qui, dans les cocktails et les dîners, vous expliquent aussi bien le bouddhisme zen que les amours de Brigitte Bardot et les projets agricoles du Marché commun." Un constat sans appel qu'illustre presque chaque jour la Séquence de G.M. Non seulement la plupart des programmes sont nuls, mais plus c'est vulgaire plus le populaire paye comptant. Matzneff qui ne porte ni la démocratie aux nues, ni la Cinquième gaulliste au pinacle finit par se demander si l'ORTF n'a pas été créé pour endormir les masses et les abétir. Il prend pour cible le duo de la vulgarité, Guy Lux et Zitrone, Albert Raisner, triste joueur de flute d'une jeunesse débile, le pauvre Max-Pol Fouchet et ses nivetés staliennes et d'autres, tant d'autres qui sont tombés depuis dans l'oubli médiatique. Seuls trouvent grâce à ses yeux Jean-Chritophe Averty, le plastiqueur du petit écran, Béart, Astruc, Marcel Bluwal, l'immense Jean-Marie Drot, Brigitte Bardot et... les jambes des jolies speakerines.
A l'image de Combat, qui change chaque jour d'humeur, les billets de Matzneff reflètent, eux aussi, toutes les dispositions d'âme de leur auteur : anarchiste hier, égotiste aujourd'hui, royaliste demain. Elles sont surtout l'occasion de donner libre cours à ses passions - le bonheur, la bonne littérature - de célébrer l'orthodoxie - qui gagnera au passage une émission le dimanche - de défendre ses dissidents russes - qui connaissent pour certains leur premier exil parisien - et de célébrer ses maîtres - de Lucrèce à Montherlant. La Séquence est faite de toutes les couleurs de l'époque, elle exprime une insouciance, une candeur, un provincialisme, une forme de candeur et douceur de vivre qui est alors le visage de la France. Dans sa préface, le Matzneff d'aujourd'hui, contemplant le Matzneff d'hier, se souvient qu'il a souvent souri, parfois jusqu'aux éclats de rire. Ces créatures de télévision avaient si peu d'existence ! Il était juste de s'en moquer, de les conspuer, de ne pas les prendre au sérieux. Mais il faut avoir aussi un peu d'affection pour ce monde englouti, car il fut celui de notre jeunesse, de nos premières émotions d'homme, de nos premières amours. Du persiflage à la nostalgie, il n'y a qu'un pas. Les hommes libres le franchissent sans crainte.
Eugène Charles.
[1]. Gabriel Matzneff, La séquence de l'énergumène, Ed. Léo Scheer, 344 pages
| Limonov |  |
Bruno Lafourcade.
[1]. Plus on relit le fameux article du 6 décembre 1986, intitulé « Le monôme des zombies », où Pauwels parlait de « sida mental », plus on le trouve juste et réjouissant. La génération des actuels quarantenaires était décrite sans fards comme « les enfants du rock débile, les écoliers de la vulgarité pédagogique, les béats de Coluche et Renaud nourris de soupe infra idéologique cuite au show-biz, ahuris par les saturnales de “touche pas à mon pote”, et, somme toute, les produits de la culture Lang. Ils ont reçu une imprégnation morale qui leur fait prendre le bas pour le haut. Rien ne leur paraît meilleur que n’être rien, mais tous ensemble, pour n’aller nulle part. (...) Ils ont peur de manquer de mœurs avachies. Voilà tout leur sentiment révolutionnaire. C’est une jeunesse atteinte d’un sida mental. (...) Nous nous demandons ce qui se passe dans leurs têtes. Rien, mais ce rien les dévore. » Etc. C’était non seulement bien écrit mais c’était bien envoyé ; et, davantage, c’était vrai.
[2]. Hallier, qui était prêt à tout pour passer à la télévision, avait été jusqu’à dire qu’il avait un chien, qu’il en avait toujours eu un, qu’il n’avait jamais rien écrit hors de la présence de ce chien adoré (bien entendu, de sa vie entière il n’avait eu de chien), – et ce dans l’unique but de passer dans l’émission Trente millions d’amis. L’émission est programmée, un ami prête son chien à Hallier; en conséquence de quoi, au cours de l’émission, le chien pas dupe finit par mordre Hallier. Une conclusion morale, donc.

|
|
Revue trimestrielle
N°1 - 2009/01 |
|
Présentation
|