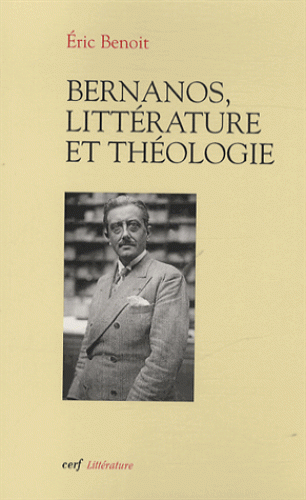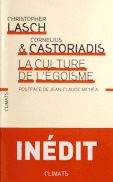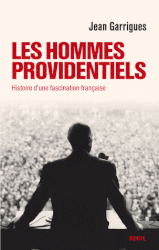Le point de vue de La Revue Critique.Voilà un livre qu’il est difficile de résumer en quelques lignes, tant sa matière est riche et tant les pistes qu’il ouvre sont nouvelles et prometteuses. Son auteur, Jean-Pierre Dupuy, ingénieur des mines, philosophe, épistémologue, est un des meilleurs esprits de notre temps. Il y traite non seulement de la genèse de la pensée économique, mais aussi de ses dérives actuelles et des moyens de la remettre sous contrôle. Vaste programme s’il en est et qui renvoie à tout moment à des questions pleines d’actualité. On retiendra que, pour Dupuy, la place qu’a prise l’économie dans les cerveaux contemporains n’est en rien le fruit du hasard. Elle a rempli un vide, celui laissé par le retrait du sacré. Elle a imposé sa loi comme les religions avaient imposé la leur. Tout comme les anciennes croyances, elle fascine les esprits par sa capacité à appréhender le monde dans son ensemble, à imposer partout ses normes et sa vision de l’avenir. Sa rationalité ne se discute pas ; si ses dogmes font plus ou moins débat, son emprise sur la politique, la culture et y compris sur la vie intime des individus est chaque jour plus sensible. Cette toute-puissance de l’économie n’a pourtant rien d’irrésistible. Comme le souligne Jean-Pierre Dupuy, elle est le résultat d’une usurpation et d’une mystification. Usurpation, car l’économie s’est peu à peu dégagée de la philosophie, dont elle fut longtemps une des disciplines, – d’Aristote à Marx –, pour cannibaliser à son seul profit le monde des idées. Elle agit désormais en dehors de tout principe supérieur, sous ses propres bannières, avec ses propres lois. Et avec ses propres penseurs qui n’ont pas attendu longtemps pour prendre la place des philosophes. Mystification, car sa pseudo rationalité n’est qu’une vue de l’esprit. Si les pères fondateurs de l’économie moderne, comme Adam Smith, ont eu recours à des images aussi pauvres que la « main invisible », c’est pour être compris par le plus grand nombre. En réalité, Dupuy démontre, textes à l’appui, que pour Smith comme pour ses continuateurs, libéraux, marxistes ou keynésiens, c’est moins la volonté de s’enrichir que le désir de créer l’envie, la jalousie, de susciter la passion chez les autres qui suscite l’accumulation des richesses. C’est moins la logique d’accumulation marxiste que la rivalité mimétique de Girard ou l’hubris, l’instinct de démesure d’Aristote, que l’on trouve ici à l’œuvre, sous le vernis de la raison économique. Et l’on sait de quelle violence sociale cette rivalité mimétique et cet hubris peuvent être les porteurs, si l’on n’y prend pas garde. En particulier dans la période de crise aiguë que le monde connait aujourd’hui. Pour sortir de cette logique destructive, conclut Dupuy, il faut remettre les choses dans l’ordre et l’économie à sa place. A défaut de transcendance, c’est à la politique que doit revenir l’autorité supérieure. Une politique substantielle, et selon la formule de Dupuy, prophétique, au sens où elle ne doit pas se contenter de gérer les êtres et les choses mais où elle doit tracer des directions et donner une envie d’agir aux hommes et aux communautés. C’est à ce prix que le monde retrouvera son sens et que l’on pourra à nouveau disserter des valeurs qui fondent la vraie richesse des nations.
vincent maire.
Entretien avec Jean-Pierre Dupuy. - La Croix, 5 avril 2012
Professeur émérite à l’École polytechnique et à l’université Stanford, Jean-Pierre Dupuy analyse la crise actuelle en dénonçant la place prise par l’économie dans nos sociétés.
Dans« l’avenir de l’économie », vous dénoncez l’«économystification» de notre société. À quoi se reconnaît-elle ?
> Par exemple, au vocabulaire que les médias emploient pour parler de la crise. On parle étrangement des « marchés », comme s’il s’agissait d’un personnage fantomatique et pluriel, un sujet sans sujet… Or à quoi peut bien se référer ce pluriel, « les marchés », sinon aux multiples tentacules enchevêtrés d’une grosse bête stupide et sans nerfs, qui s’affole au moindre bruit et réalise cela même qu’elle anticipe avec terreur. J’ai cherché à faire oublier cette image. Ce que l’on voit alors, ce sont des hommes en position de pouvoir qui se couchent devant un fantasme, le transformant ainsi en chose réelle dotée d’une force extraordinaire.
Comment expliquez la place prise par l’économie dans nos sociétés ?
> L’économie occupe la place laissée vacante par le retrait du sacré. On voit d’ailleurs bien que « les marchés » officient comme un grand prêtre. Comme un grand sacrificateur, « les marchés » se préparent à offrir en holocauste aux dieux de l’Olympe le nombre de victimes qu’ils leur demandent. Qui ne voit que cette rhétorique reprend les termes du sacré le plus primitif et constitue une incroyable régression par rapport aux valeurs les plus fondamentales de la modernité démocratique ? Nous devons sortir de l’économystification dont nous sommes les victimes.
Votre charge est puissante contre les économistes. Que leur reprochez-vous ?
> Si j’accuse les économistes, c’est pour leur naïveté. Ils se trompent eux-mêmes et sont victimes d’un auto-aveuglement. Ils croient – et nous font croire – que l’économie est l’étude de l’allocation des ressources rares, étude qui serait de l’ordre de la rationalité, de la mesure, de la « bonne gestion de la maisonnée » comme disaient les Grecs anciens. Tous se réfèrent à Adam Smith comme à leur père fondateur, mais ils ont oublié que celui-ci était d’abord un moraliste. Ils n’ont pas lu sa Théorie des sentiments moraux, où Smith montre que ce n’est pas l’utilité que nous poursuivons, mais tout autre chose. Pour Smith, un quignon de pain et une masure suffiraient largement à assurer le bien-être matériel de chacun. Si l’économie est devenue la quête de l’illimité, c’est qu’elle obéit à une logique du désir et non pas du besoin. Nous recherchons, dit-il, la « sympathy », l’admiration teintée d’envie des autres. Ce sont les passions qui font marcher l’économie. Adam Smith et Max Weber voient bien qu’il y a du spirituel (même s’ils n’utilisent pas ce mot) derrière cette quête d’infini. L’économie est devenue l’incarnation du« mauvais infini », comme dit Hegel.
Cette crise économique, dites-vous, est une crise de notre rapport à l’avenir. Comment s’explique-t-elle ?
> Sous certaines conditions, l’économie « ouvre » l’avenir. Elle a eu cette capacité de nous projeter dans l’avenir, cette manière de nous arracher à nous-mêmes, mais elle a besoin pour cela du politique. Si l’économie se paye le politique – dans tous les sens du mot –, comme c’est le cas aujourd’hui, elle scie la branche sur laquelle elle est assise. Une voie de sortie serait de rétablir le politique dans sa fonction prophétique, qui est de désigner une direction dans l’avenir. C’est ce rapport à l’avenir qui est aujourd’hui en crise. De là vient que l’économie est hantée par le spectre de sa fin. Je crois aussi que, inconsciemment au moins, tous les acteurs ont intégré la contrainte écologique. Nous savons que notre croissance aura une fin, mais nous ne savons pas quand elle interviendra. Cela peut expliquer ce qu’Alan Greenspan appelait « l’exubérance irrationnelle des marchés ».
Voyez-vous venir un sursaut politique ?
> J’y appelle, mais il me paraît en même temps peu vraisemblable. Regardez, hélas, le niveau du débat politique aujourd’hui. Cette campagne est désolante. Nos élites, de droite comme de gauche, sont complètement économystifiées. Chaque fois que le politique dit se battre contre « les marchés » et se félicite d’avoir évité le pire, la puissance se place au même niveau que l’intendance. Qu’elle gagne ou qu’elle perde, peu importe, elle a déjà perdu par le fait même de se battre. Le succès de Jean-Luc Mélenchon s’explique par le fait qu’il pose les vrais problèmes et veut redonner au politique une extériorité par rapport à l’économique.
Vous êtes cependant critique à l’égard de l’anticapitalisme de gauche…
> Oui, car le problème, le « skandalon » comme disaient les Grecs, c’est l’économie. Ce que je vise, ce n’est pas le capitalisme financier, ni le capitalisme tout court, ni le marché régulé ou non. Ce que je critique, c’est la place que joue l’économie dans nos vies individuelles comme dans le fonctionnement de nos sociétés. Cette place est exorbitante et nous trouvons cela banal. L’économie tend à envahir le monde et nos pensées. « Sortir du capitalisme » est le mot d’ordre d’une gauche qui n’en voit que les méfaits, mais pour aller où ? N’oublions pas que l’économie contient la violence, dans les deux sens du mot. Elle fait barrage à la violence par des moyens violents. Seuls les borgnes ne voient que la violence de l’économie et peuvent se réjouir de sa dissolution sans autre forme de procès. Peut-être le regretterons-nous un jour, ce capitalisme honni… C’est moins du capitalisme qu’il faut sortir que de l’économystification du politique, en inventant par là même une nouvelle forme de raison économique.