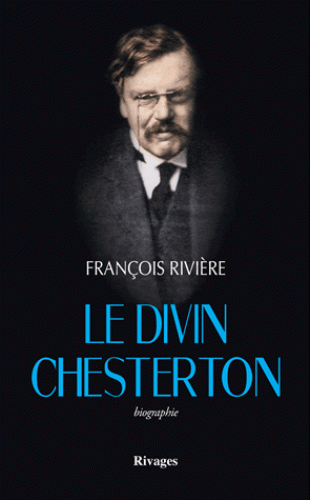Présentation de l'éditeur.
Personne, avant 1914, n'aurait imaginé qu'un jour, Barrès reconnaîtrait aux protestants, aux juifs et aux socialistes le même statut de « familles spirituelles de la France » qu'aux catholiques et aux traditionalistes. N'avait-il pas, au temps de l'affaire Dreyfus, soutenu les campagnes antisémites de Drumont, brocardé l'influence « dissolvante » du protestantisme, ferraillé contre l’« internationalisme rouge » ? Publié en 1917, au plus fort des combats du Chemin des Dames, des mutineries, de la crise morale qui saisit l'arrière, Les Diverses Familles spirituelles de la France dévoile un Barrès inattendu. Face à la commotion nationale, il se fait le chantre des « amitiés françaises » contre les germes de division qui, trop longtemps, affaiblirent le pays. « La guerre est l'occasion pour une nation déchirée de dépasser ses clivages et de mettre en commun, au service d'un but qui les transcende, l'énergie jusque-là dépensée dans la vanité des querelles de partis », lance l'écrivain-député dont le coeur bat au rythme des lettres de soldats qu'il reçoit alors par milliers. La relecture de ce classique monte que Barrès ne fut ni le « crieur public du massacre » dénoncé par Jean Guéhenno, ni le « rossignol du carnage » fustigé par Romain Rolland. Pour Barrès, en effet, le soldat se bat pour que ses enfants n'aient pas à se battre. Il fait la guerre pour détruire la guerre...
Préface de Jean-Pierre Rioux (conclusion).
Cent ans plus tard... Ne faisons pas dire à Barrès, malgré tant de propos généreusement ampoulés, qu’il considérait que la terre de salut fût en vue puisque le peuple français en armes oubliait ses divisions et rivalisait d’esprit de sacrifice, de sens patriotique, d’héroïsme d’esprit et de foi. Les Marginalia, ces réflexions notées de sa main juste après la publication du livre et publiées par son fils Philippe dans l’édition de 1930 et qu’on retrouvera ici en annexe du texte de 1917, prouvent que le doute a pu le saisir sur-le-champ et être entretenu après la Victoire. Il l’exprimera à voix haute, y compris à la Chambre et dans ses conférences, au temps du Bloc national et du retour des divisions et des haines partisanes, dès 1919. Non. C’est aussitôt qu’il s’interroge sur le sens de tant de spiritualité, d’esprit de réconciliation et de vaillance. Il griffonne en marge de son livre, visiblement décontenancé : « Ils s’évadaient de leur humanité. Vers quoi ? Serait-ce vers rien ? » ; « Mais s’ils s’étaient trompés ? » ; « A quoi tout cela est-il bon ? ». Créditons Barrès de cette angoisse-là ; de ce tremblement au spectacle de l’affrontement entre une Histoire affreusement nouvelle et l’âme antique de la nation; de ce point de suspension.
Observons aussi que dans le texte originel comme dans ses Cahiers des incidentes révèlent qu’en publiant ce livre il reste d’abord fidèle à son « innéité » et revendique, cette fois sans désemparer, la continuité et la rectitude de son labeur national. En 1911, Les Amitiés françaises, petit traité d’éducation à l’usage des nouvelles générations et particulièrement de son fils Philippe, avait averti. Assurément, écrivait-il, fort d’un postulat posé dès 1889 dans Un Homme Libre, « des individus qui ne se mettent pas d’accord avec eux-mêmes et qui contrarient leur innéité font de détestables éléments sociaux » ; c’est artifice et mensonge de laisser croire qu’un être, individu ou collectivité, peut grandir « en dehors de sa vérité propre ». Mais, autre postulat, la « froide déesse Raison » veut qu’ « un petit enfant chez qui l’on distingue et vénère les émotions héréditaires, qu’on meuble d’images nationales et familiales tout au cours de sa vie, dans son fond possèdera une solidité plus forte que toutes les dialectiques, un terrain pour résister à toutes les infections, une croyance, c’est-à-dire une santé morale ». Oui, poursuit-il, « on peut dégager chez un jeune garçon ses dispositions chevaleresques et raisonnables, le détourner de ce qui est bas, l’orienter vers la vérité, susciter en lui le sentiment d’un intérêt commun auquel chacun doit concourir, le préparer enfin à se comprendre comme un moment dans un développement, comme un instant d’une chose immortelle ».
Toutefois, croyance et solidité morale resteront inopérantes si n’a pas été entretenue la fidélité de tous et chacun au « trésor national ». C’est pourquoi en 1913, juste après la publication de La Colline inspirée, Barrès s’est lancé passionnément dans la bataille parlementaire qui a abouti à l’adoption d’une loi de protection et de promotion des monuments historiques – celle qui encore aujourd’hui n’a rien d’obsolète. Il en a tiré argument dans La Grande Pitié des églises de France, publié en février 1914, pour signaler la montée d’une conscience patrimoniale, d’une unification du domaine sacré et donc d’une mobilisation , déjà, du divin dans la France menacée de guerre, juste avant la destruction par la « race » et la « barbarie » allemande de a cathédrale de Reims et la ruine de tant de clochers repères d’artillerie, bien avant le salut de 1919 aux statues de la cathédrale de Strasbourg : oui, les saints, les prophètes et la Vierge ont formé et reformeront la haie d’honneur de nos soldats « pour leur chevalerie ».
Spiritualité et morale civique, conscience de la grandeur nationale et valorisation du patrimoine hérité n’ont donc fait qu’un pour lui. Les malheurs et les ardeurs de la guerre n’ont fait que renforcer l’unicité spirituelle et sacralisée, monumentale et populaire, de l’espace public. Mais celle-ci reste guidée par « la déesse Raison » ; elle est, grâce aux savants, aux instituteurs et aux catéchistes main dans la main, l’agencement terriblement humain d’une conscience plus aigüe du réel, d’une concordance des croyances et d’une intelligence à la française confortée par la science et la recherche, par la diffusion toute républicaine des savoirs et de l’instruction.
Cet impératif de « reconstitution intellectuelle » à jet continu hantera Pour la haute intelligence française publié en 1925, après sa mort, à l’initiative de Philippe Barrès et préfacé par Charles Moureu, l’éminent chimiste, celui qui avait lancé l’industrie française dans la production des gaz de combat en 1915 après le massacre au chlore commis par les Allemands à la bataille d’Ypres. Charles Moureu tient à dire de Barrès que ce « prince des lettres fut un ami des sciences, et [qu’en servant] la cause des sciences il servit la Patrie et l’Humanité. Avec son arrière plan guerrier, cette ultime publication complète et achève un cheminement scandé par La Grande Pitié et Les Diverses Familles. Elle est un hymne à l’organisation nécessaire de la science chez les « fils spirituels de Pasteur ». Malgré « la grande pitié des laboratoires de France », plaide Barrès, maîtres et étudiants d’après la guerre auront toujours en charge « une belle besogne d’unité française ». Car autant que l’éclat des arts et des lettres, le développement des sciences et des techniques, outre qu’il conforte la défense nationale, assied l’idéal d’humanité et la présence de la France dans le monde du XXe siècle. Elle assure mieux que par des discours et des idéologies l’adaptation de l’esprit public aux temps nouveaux et aux amitiés ferventes renouées au front. Cette ode barrésienne à la modernité technicienne ne peut qu’intéresser et peut-être toucher son lecteur d’aujourd’hui. Car celui-ci sent encore trop bien que l’Université et la Recherche restent en France toujours à la peine, par défaut d’ambition rajeunie par le fracas d’un monde nouveau, par négligence intellectuelle d’y puiser une réserve de vitalité.
Tel est chez Barrès l’encadrement, raisonné par l’intelligence collective et le développement de la connaissance, de la spiritualité de la famille recomposée. Son argumentation, à discuter mais forte, est d’une telle actualité cent ans plus tard qu’elle éclipse le débat entre historiens lancé par Zeev Sternhell depuis son Nationalisme de Maurice Barrès de 1972 et qui ne nous intéresse guère ici, puisqu’il n’a jamais pris en ligne de compte Les Diverses Familles Spirituelles. A la lecture de celles-ci, on considèrera simplement, avec Pierre Milza, Serge Bernstein et Michel Winock, que tout au contraire, cette harangue de 1917 apporte une triple preuve. La première : Barrès a su abandonner son antisémitisme des années 1890 au profit d’une bénédiction toute républicaine de l’acquiescement patriotique et héroïque des « israélites » à la cause nationale. La deuxième : il a conçu et tenté de promouvoir un élargissement et une élévation du regard nationaliste sur la France issu du boulangisme, de l’antidreyfusisme et des sursauts des « jeunes gens d’aujourd’hui » à la veille de la guerre, puisque l’Union sacrée maintenue redistribue les cartes en faveur d’ »amitiés françaises » à prolongement universel, puisque l’esprit de compréhension l’emporte sur l’invective et la division. La troisième : Barrès, fort de cette évolution et de cette exigence, tout empreint d’histoire et de patrimoine qui font la Nation une colline inspirée, une floraison d’héritages et de continuités et non plus une machine de guerre idéologique poussant à la rupture violente et à la transparence assassine, n’a pas participé d’un fascisme à la française.
Fermons le ban. Et rêvons un peu, voulez-vous, en découvrant ou feuilletant ce petit livre négligé. Voici que nous revient le mot d’André Malraux à propos du message de ce Barrès prétendument moisi : « Si étrangères qu’elles nous soient, ne marchandons pas – ajoutons : avec lui, grâce à lui – notre admiration aux hautes valeurs amputées ».
Car voici qu’en 2015 et 2016, dans une France tout autre mais où le sang a coulé et le mot guerre a été avancé, où la Marseillaise et les drapeaux ont refleuri, où « la promesse d’une même France » a secoué l’opinion et conquis les médias les plus populaires, un président de la République qui n’a rien de barrésien a tenu pour acquis que l’unité nationale se reconstruit aux pires moments, que sa diversité est fondatrice et que l’avenir commun participe encore du mot « patrie ». Au lecteur, aujourd’hui, de soupeser ce rapprochement.