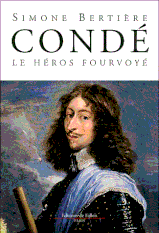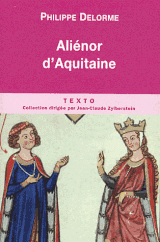Née en 1926, Simone Bertière est biographe et écrivain. Elle est l'auteur de nombreux articles sur la littérature comparée, qu'elle a enseignée à Bordeaux puis à l'Ecole normale supérieure de jeunes filles. Elle a récemment publié : Mazarin, le maître du jeu (De Fallois, 2007) - Dumas et les "Mousquetaires", histoire d'un chef d'oeuvre (De Fallois, 2009).
Simone Bertière, Condé, le héros fourvoyé . Paris, De Fallois, octobre 2011, 544 pages.
Présentation de l'éditeur.
A vingt-deux ans, il passait pour l'égal de César et d'Alexandre. De 1643 à 1648, durant la guerre franco-espagnole, il accumula les exploits et devint l'idole de la jeune noblesse d'épée. Il avait tout, naissance et fortune. Il ne lui manquait que d'être roi. Se croyant tout permis, il rejetait obstacles et interdits et cultivait le scandale. L'action politique, où il s'engagea imprudemment, fut son talon d'Achille. Il soutint d'abord Anne d'Autriche et Mazarin lorsque les magistrats déclenchèrent contre eux la Fronde parlementaire. Mais pour prix de ses services, il montra une telle arrogance et afficha des prétentions si outrées qu'elles lui valurent une année de prison. A sa sortie, il se jeta dans une guerre civile qu'il perdit et, plutôt que de s'incliner, il alla mettre son génie militaire au service des Espagnols, sans pouvoir empêcher leur défaite finale. De retour après la paix des Pyrénées, il se résigna à n'être qu'un homme privé, dans une France qui avait profondément changé. Il opéra alors une extraordinaire mutation psychologique et morale, faisant de son domaine de Chantilly un haut lieu de culture, de tolérance et de paix. A travers l'histoire d'un héros, ce livre invite à réfléchir à la gloire, à ses enjeux, à ses dérives. En arrière-plan, il évoque, avec la régente, Gaston d'Orléans, Mazarin, Turenne et le jeune Louis XIV, les grandes figures d'une époque où les derniers sursauts de l'esprit féodal s'effacent pour laisser place à la France moderne. Bien que solidement documenté et non romancé, il s'anime sous la plume alerte de Simone Bertière de plaisantes anecdotes et se colore d'humour.
Article de Jean Sévillia. - Le Figaro Magazine, 12 novembre 2011.
Le Grand Condé, prince, capitaine et mécène. C'est Bossuet, en 1687, qui prononça à Notre-Dame de Paris l'oraison funèbre du «Très Haut et Très Puissant Prince Louis de Bourbon, Prince de Condé, Premier Prince du Sang». Le plus bel hommage était venu de Louis XIV : «Je viens de perdre le plus grand homme de mon royaume.» Ils s'étaient réconciliés depuis longtemps, mais comment oublier que Condé, après avoir été le plus grand capitaine du roi de France, était resté pendant huit ans son pire ennemi ?
Simone Bertière, auteur d'ouvrages de référence sur les reines de France au temps des Valois et des Bourbons et biographe de Mazarin, s'est passionnée pour la question, qui oriente le livre qu'elle publie aujourd'hui sur Condé, «le héros fourvoyé». «La présente biographie, explique-t-elle, tourne autour d'une interrogation majeure : sa rébellion, qui l'amena d'abord à allumer sur place la guerre civile, puis à combattre dans les rangs espagnols, fut-elle vraiment un accident ou l'aboutissement prévisible d'un itinéraire?»*
Louis II de Bourbon, quatrième prince de Condé, dit le Grand Condé, naît à Paris en 1621. Sa famille, issue d'un oncle d'Henri IV, forme une branche des Bourbons où l'on est volontiers rebelle. Son arrière-grand-père, Louis de Bourbon, chef du parti huguenot, trempa dans la conjuration d'Amboise et mourut en affron tant les troupes royales à la bataille de Jarnac. Son grand-père, Henri Ier de Bourbon, cousin et compagnon d'Henri de Navarre, s'opposa à ce dernier quand il devint le roi Henri IV. Son père, Henri II de Bourbon, fut emprisonné pour avoir pris la tête des grands contre Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, et son favori Concini.
En 1627, quand le jeune Louis s'apprête à entrer au collège, son père est cependant rentré en grâce et sert loyalement Louis XIII et son ministre Richelieu. Titré duc d'Enghien, le garçon devient un brillant élève des jésuites de Bourges. Celui qui se destine à la carrière des armes, comme l'exige son rang, reçoit, après ses 14 ans, une formation complémentaire en droit, en histoire et en mathématiques.
En 1640, Louis de Bourbon subit le baptême du feu à Arras, où se dévoilent ses qualités militaires. L'année suivante, il épouse une nièce de Richelieu, Claire Clémence de Maillé-Brézé, qu'il n'aimera jamais. Vainqueur à Perpignan en 1642, quelques mois avant la mort du cardinal ministre, il entre dans la gloire à Rocroi en 1643 - le jour même des funérailles de Louis XIII - en remportant une victoire décisive sur les tercios espagnols, réputés invincibles. A 22 ans, Condé vient de sauver Paris de l'invasion et passe pour l'égal de César et d'Alexandre. Successivement commandant des armées de Flandre et de Picardie, gouverneur de Champagne et de Brie, gouverneur de Guyenne, du Berry et de Bourgogne, grand maître de France, commandant sur le Rhin avec Turenne avec qui il remporte la victoire de Nördlingen, commandant pendant la campagne de Flandre au cours de laquelle il s'empare de Dunkerque, tout lui réussit. Et en 1646, à la mort de son père, il devient le premier prince du sang.
Désormais, il a tout : la naissance, la fortune, et un rare génie militaire soutenu par le courage physique. Toutefois, arrogant, doté d'une très haute idée de lui-même, il nourrit une ambition démesurée. «Il ne lui manque que d'être roi», observe Simone Bertière. C'est précisément cet orgueil qui va le perdre. Après six années glorieuses, Condé, qui ne peut pas monter plus haut, va descendre du pinacle où son talent l'avait hissé.
S'il entre au Conseil du roi en 1647, ses rapports avec Mazarin, qu'il méprise, sont difficiles. Un échec en Catalogne lui vaut d'être écarté du commandement en chef dans les Flandres, en 1648, même s'il prend sa revanche sur les Espagnols à Lens la même année, victoire qui hâte la conclusion des traités de Westphalie, mettant fin à la guerre de Trente Ans. Lorsque éclate la Fronde, il hésite entre son ressentiment contre Mazarin et le dédain que lui inspirent les parlementaires et les chefs de la révolte nobiliaire, auxquels il s'estime supérieur. Il sauve le trône, dans un premier temps, en mettant le siège devant Paris (1649), mais finit par rejoindre les frondeurs. Arrêté sur ordre de Mazarin en 1650, il est interné treize mois à Vincennes, puis au Havre.
Libéré en 1651, Condé prend la tête de la Fronde des princes, lève des troupes et combat l'armée du roi. Battu par Turenne, au faubourg Saint-Antoine, en 1652, déchu de ses dignités et gouvernements, privé de ses biens, qui lui sont confisqués, il passe dans l'armée espagnole et poursuit la guerre sur les lieux mêmes où, dix ans plus tôt, il servait la France : Rocroi, Arras, Valenciennes, Cambrai. En 1654, la justice royale le condamne à mort. Mais en 1658, Turenne écrase les Espagnols à la bataille des Dunes (où Condé n'était pas), et la paix des Pyrénées est signée en 1659.
En 1660, Louis XIV accorde son pardon au prince rebelle, qui finira par reprendre du service après plusieurs années d'inactivité. En 1668, Condé conquiert la Franche-Comté en trois semaines. En 1674, pendant la guerre de Hollande, il bat le prince d'Orange à Seneffe. En 1675, successeur de Turenne en Alsace, il est vainqueur des Impériaux à Saverne : ce sera sa dernière campagne. Perclus de goutte, il prend sa retraite et entame une nouvelle vie. Dans son domaine de Chantilly, acquis en 1643, Monsieur le Prince cultive les lettres et les arts et entretient Boileau, Racine ou La Bruyère. Il meurt à Fontainebleau en 1686.
Simone Bertière, dans ce beau livre, brosse le portrait d'une figure flamboyante. A travers cet homme, c'est aussi une époque qu'elle dépeint : on voit émerger la France moderne au milieu des sursauts ultimes de l'esprit féodal, dont le Grand Condé, à sa manière fastueuse, fut le représentant emblématique .
Autre critique. - Marc Riglet, "Condé, prince des frondeurs", Lire, novembre 2011.