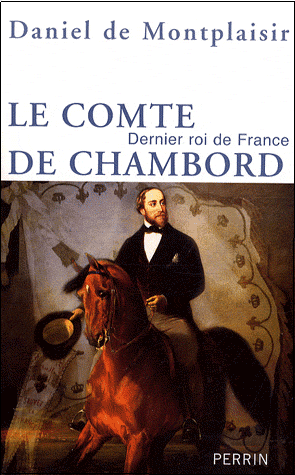| La Fontaine chez les voleurs
Une nouvelle de Jules Lemaître | |  |
Vers minuit, Jean de La Fontaine sortait d’une maison de la rue Saint-Jacques où il avait soupé avec quelques amis. Il portait une lanterne, car la nuit était sombre, et la ville n'avait point encore de réverbères. Mais, comme il passait sur le pont Notre-Dame pour regagner son logis, un coup de vent souffla le lumignon, que Jean ne put rallumer, ayant oublié son briquet.
Il vit alors un homme qui marchait devant lui en tenant à la main une chandelle de résine, et dont une longue rapière relevait la cape à l'espagnole. La Fontaine se mit à le suivre pour profiter de l'éclairage. Mais, au moment où ils arrivaient, l'un devant l’autre, au tournant du quai, l'homme tira de sa poche un éteignoir à cierges, avec quoi il éteignit son oribus, se jeta au collet de La Fontaine, et lui demanda poliment, mais avec fermeté, la bourse ou la vie, « pour se payer, disait-il, de la peine qu'il avait prise de le conduire ».
— Monsieur, lui dit Jean, je préférerais ne vous donner ni l'une ni l'autre; mais, puisque vous me laissez du moins le choix, j'aime mieux vous donner ma bourse.
Il fouilla longuement dans ses chausses et n'y trouva rien.
— Monsieur, reprit-il, cela est fâcheux, mais j'ai oublié ma bourse, ainsi que vous pouvez vous en rendre compte. II ne me reste donc à vous offrir que ma vie; mais que ferez-vous de la vie d'un pauvre poète ?
— Ah! Monsieur est poète ? dit le voleur d'un air d'intérêt.
— Ou du moins j'y tâche, répondit Jean. Mais je me suis aperçu, en explorant mes chausses, que j'avais oublié la clef de mon logis en même temps que ma bourse et mon briquet. Si bien que me voilà forcé de passer la nuit à la belle étoile; ce qui n'est qu'une façon de parler, car je ne vois non plus d'étoiles au ciel que d'écus dans ma poche. A moins que je ne trouve quelque taverne encore ouverte à cette heure où l'on me veuille bien faire crédit jusqu'à demain.
— Monsieur, dit le voleur, vous me paraissez civil et de bonne compagnie, et vous possédez, en outre, cette tranquillité d'âme qui est le propre du sage. C'est moi, si cela ne vous désoblige point, qui aurai l'honneur de vous offrir l'hospitalité dans ma modeste maison.
— Monsieur, dit La Fontaine, j'accepte avec reconnaissance.
Le voleur ralluma sa chandelle de résine. Les deux hommes purent s'examiner à loisir, et semblèrent satisfaits l'un de l'autre. Le voleur, vêtu d'un pourpoint de satin noir, emprunté sans doute à quelque riche bourgeois, d'un haut-de-chausses de drap du Berry, et d'une roupille de serge, avait une face martiale, mais sans dureté, et où la moustache seule était terrible par l'exagération de ses crocs. Et Jean de La Fontaine plut tout de suite à son compagnon par son nez débonnaire, son regard confiant et son costume négligé, qui était vraiment d'un poète ou d'un philosophe.
Ils s'engagèrent dans la rue Saint-Denis, et devisèrent chemin faisant.
— Monsieur, dit le voleur, j'honore les poètes. Et je suis poète moi-même à mes moments perdus. J’ai commencé mes humanités au collège de Navarre et je serais peut-être, à l'heure qu'il est, régent de rhétorique, si des infortunes imméritées ne m'avaient contraint de chercher une autre profession. Celle que j’exerce n est pas des mieux famées; mais j'ennoblis du moins les loisirs qu'elle me laisse en les consacrant au culte des Muses. Je feuillette d'une main diurne et nocturne les plus fameux de nos rimeurs : MM. de Corneille, de l’Estoile, de La Serre, Hardy, Théophile, Saint-Amand, Boyer, Chevalier, Cotin, Ménage et Tristan. J'écris au hasard de ma verve rondeaux, acrostiches, sonnets, épithalames, odes et madrigaux. Mais je cultive principalement le genre familier. Je fais des chansons pour les colporteurs, et c'est moi qui fournis le Savoyard et le Boiteux de tous les refrains nouveaux avec quoi ils ont triomphé dans les carrefours et dans les meilleurs cabarets. Je crains d'abuser de la complaisance d’un confrère qui n'a pas eu tout d'abord à se louer de moi; mais je ne saurais cependant renoncer à 1’avantage d'être entendu par un juge aussi compétent que vous me paraissez être, et, si vous me permettiez de vous soumettre quelques fruits de mes veilles...
— Monsieur, dit La Fontaine, je vous écoute.
Le voleur, avec des gestes qui faisaient dessiner à sa chandelle de résine de grands paraphes lumineux, déclama une ode sur les victoires du roi, puis la dernière chanson qu'il avait composée pour le Savoyard, dans laquelle étaient célébrés les mérites du tabac et où l'on voyait le poète préférer sa pipe à sa maîtresse.
— Monsieur, dit La Fontaine, l'ode est sublime; mais la chanson me plaît davantage par sa simplicité et son tour populaire.
— Monsieur, répondit le voleur, je crois que vous en jugez comme il faut. Je suis d'ailleurs d'un si bon naturel que je pardonne à ceux qui n'admirent pas également tous mes ouvrages et qui font un choix entre les produits de ma veine. Mais vous-même, Monsieur, ne me ferez-vous pas l'honneur, je ne dis point de soumettre à mon faible jugement, mais de proposer à mon admiration quelques-unes de vos rimes ?
— Monsieur, dit La Fontaine, après l'obligeance de votre procédé envers moi, je ne vous saurais refuser une faveur si menue. Je vous réciterai donc un morceau que j'achevai ce matin même, et où j'ai essayé de mêler la tendresse avec le badinage, car tel est mon goût.
Et il récita, à voix presque basse, un petit hymne à la Volupté, qui se terminait ainsi:
Volupté, Volupté, qui fus jadis maîtresse
Du plus bel esprit de la Grèce...
— Épicure, sans doute ? interrompit le voleur.
— Vous l'avez dit, Monsieur.
Il continua :
Ne me dédaigne pas, viens-t'en loger chez moi !
Tu n'y seras pas sans emploi.
J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique,
La ville et la campagne, enfin tout : il n'est rien
Qui ne me soit souverain bien,
Jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique...
Le voleur demeura un instant silencieux et comme frappé de stupeur; ensuite il fit claquer plusieurs fois sa langue; puis, ôtant son chapeau et s'inclinant jusqu'au pavé :
— Monsieur, dit-il, ce sont là des vers, de véritables vers, et tels que je ne me souviens pas d'en avoir entendu. Ils paraissent éclos sans plus d'efforts que les fleurs. Je connais présentement que je ne suis qu'un écolier et que vous êtes un maître. Croyez, Monsieur, que je suis dorénavant tout à votre service. Mais ne pourriez-vous me dire le nom de l'homme merveilleux qui vient de me révéler, en quelque sorte, ce que c'est que la poésie ?
— Jean de La Fontaine, Monsieur, pour vous servir à mon tour. Mais je ne pense pas que ce nom soit parvenu jusqu'à vous, car mes rimes n'ont point encore été imprimées. Et vous, Monsieur, répugneriez-vous à me confier le nom de l'honorable spadassin qui se montre si bon appréciateur des présents des Muses ?
— Monsieur, dit le voleur, je ne vous cacherai point qu'on m'appelle le capitaine Cascaret. Non que j'aie l'avantage d'être officier de Sa Majesté le roi; mais j'ai cependant mes troupes, ainsi que vous l'allez voir.
* *
*
Les deux hommes, en effet, ayant atteint la porte Saint-Denis, puis tourné à droite, s'arrêtèrent devant une maison assez grande, mais d'apparence minable, bâtie sur le rempart.
— C'est ici, dit Cascaret.
Ils entrèrent dans une grande salle, au plafond bas et enfumé, mal éclairée par quelques chandelles, où des hommes attablés buvaient dans des pots d'étain et pétunaient dans de longues pipes de Hollande.
Tous se levèrent en voyant entrer Cascaret. Il leur présenta son compagnon en ces termes :
— Monsieur est un ami, ayez pour lui des égards.
Puis il avisa une table restée libre et invita La Fontaine à s'y asseoir près de lui. Une grosse servante leur apporta une bouteille et deux gobelets.
— Vous pouvez parler devant Monsieur, dit Cascaret à ses hommes.
Alors, à mesure qu'il les appelait : « Bondrille! La Brèche! La Boline! Langevin! Rustaud! Brindestoc! » ils vinrent l'un après l'autre, chapeau bas, lui rendre compte de leurs travaux de la soirée. Plusieurs lui remirent des bijoux de diverses sortes, colliers, anneaux, croix ou bracelets, et beaucoup d'or et d'argent monnayé, parmi quoi il y avait des pièces fort légères : mais le chef ne se mit pas en peine de chercher un trébuchet, sachant bien que ses commis, les ayant reçues sans les regarder, n étaient pas obligés de les lui garantir trébuchantes. D’autres apportèrent des manteaux, des chapeaux, des pièces d’étoffe, des ustensiles de cuisine et divers objets d'utilité ou d'agrément, que Cascaret fit mettre en tas dans un coin de la salle.
— C'est bon, Messieurs, dit-il enfin. On vous fera demain la distribution. Vous pouvez retourner boire.
Jean de La Fontaine avait considéré la scène avec une bienveillante curiosité.
— Monsieur, dit-il à Cascaret, j'admire que vous ayez su ordonner ainsi le désordre et faire régner, parmi des gens à qui je ne fais point tort en les supposant hors la loi, une discipline et une obéissance que l'on rencontre rarement même dans la société régulière.
— Monsieur, répondit Cascaret, je n'y ai, je vous assure, aucune peine. Parce que j'ai étudié et que je me pique d'aligner des rimes, j'ai, parmi ces braves gens, le renom d'un esprit hors de pair, et à cause de cela, ils m'obéissent volontiers. Ils reconnaissent à leur manière le doux empire des Muses. Et pourtant beaucoup sont plus habiles que moi, et je ne saurais vous dire l'infinie variété des stratagèmes qu'ils inventent. Celui-ci, qu'on appelle Bondrille, et qui, l'année dernière encore, s’escrimait contre les ondes avec une épée de bois...
— Vous voulez dire qu'il ramait sur les galères du roi ?
— Tel est, en effet, le sens de cette figure de rhétorique. Bondrille, donc, est un des plus adroits de la compagnie. Dans les marchés, il contrefait le paysan, on le voit au Palais vêtu en procureur; parmi les grands, il paraît ajusté en gentilhomme. Dans tous ces lieux, s'il trouve quelque chose qui lui convienne, il y pose la main aussitôt que la vue. Celui-là, Brindestoc, fournit ses compagnons de lames d’épée qui lui reviennent fort bon marché; car, entrant chez un fourbisseur avec un fourreau vide à son côté, il glisse dans ce fourreau une lame neuve pendant que le fourbisseur lui en fait voir d’autres. Ce troisième, La Brèche, n'est pas moins ingénieux. Lorsqu'il a visité un logis en l'absence des habitants et qu'il y a fait sa main, au lieu de fuir à toutes jambes, il chemine modestement pendant quelques minutes, puis revient sur ses pas et, s il voit des gens en quête du voleur, il va doucement à leur rencontre, passe à côté d'eux et sauve ainsi son butin. Ce quatrième, La Boline, met quelquefois un cotillon par-dessus ses grègues, une écharpe sur sa tête et un masque sur son nez; ainsi déguisé, il attaque en plein jour le bourgeois dans la rue, et les passants qui les voient en contestation, croyant que c'est un mari et une femme qui ont ensemble quelque différend, ne se mêlent point de leurs affaires. Ou bien il pose, le soir, au coin d'une rue, deux mannequins habillés, et, quand un bourgeois se présente... Mais peut-être. Monsieur, que je vous ennuie ?
Jean de La Fontaine s'était endormi. Il fut réveillé par un bruit de dégringolade le long d'un escalier de bois, qu'on voyait dans un angle de la salle. C’était une troupe de femmes, — Quentine, Parthénice, Amarante, Silvie, Nanon, Gillette, Simonette et la Gibouleuse, — qui descendaient de leurs chambres, et furent se mêler aux buveurs. Deux ou trois étaient assez jolies; mais toutes étaient grossièrement fardées et vêtues de friperies, et plusieurs, sans doute à la suite de quelque rixe, s’étaient appliqué sur le visage des mouches aussi longues que des chenilles pour servir d'emplâtre à leurs égratignures. A leur entrée, une violente odeur de musc s'était répandue dans le cabaret.
Cascaret, voyant La Fontaine réveillé, continua ses explications :
— Ces dames sont les compagnes de ces messieurs et les aident à supporter une existence souvent pénible. Leur cœur est fidèle encore que ces messieurs ne leur défendent point de faire part de leurs charmes, pour des sommes modiques, aux étrangers qui d'aventure les en prient. Elles rendent à notre communauté d'autres services. Elles entretiennent notre garde-robe, et elles sont si habiles à déguiser les hardes dérobées aux bourgeois, soit en changeant les doublures et les boutons, soit en tournant le collet à l'envers, que ceux à qui ces hardes ont appartenu ne les pourraient jamais reconnaître quand elles leur passeraient devant les yeux. Ces bonnes filles habitent à l'étage au-dessus, sous la surveillance de dame Angilberte, cette vénérable duègne que vous voyez attablée là-bas avec ce gros homme roux et taciturne.
— Cet homme, dit La Fontaine, offre aux yeux une trogne horrifique à la fois et bonasse. Tels je me représente les stupides géants Lestrygons. Est-il aussi de votre troupe ?
— C'est un ami de la maison, un des aides du bourreau de Paris, et qui nous fait souvent l'honneur de venir boire en notre compagnie. Il est utile, dans notre métier, d'entretenir des relations courtoises avec les exécuteurs de haute justice, car telles gens peuvent sauver un homme condamné à la potence en lui fourrant dans la gorge la douille d'un soufflet en guise de canule pour lui conserver la respiration. Ils peuvent encore mettre une tranche de lard sur l'épaule d'un patient avant d'y appliquer les armes du roi...
— Toutes choses à considérer, dit gravement Jean de La Fontaine, à qui les yeux papillotaient, et qui ne savait plus très clairement en quel lieu il se trouvait transporté.
— Il faut, reprit Cascaret, dans une profession aussi exposée que la nôtre, penser à tout et tirer parti de tout s'il se peut. Mais, Monsieur, j'ai encore d'autres ressources que mon modeste talent de poète et ce que les lois condamnent sous le nom de larcin. C'est à moi que s'adressent les personnes qui ont à se venger de quelque ennemi. Nous tenons bureau de coups d'épée, de coups de nerfs de bœuf, de bastonnades ou de simples nasardes, chaque article étant tarifé au plus juste. Du reste, nous n'allons jamais jusqu'au meurtre, car nous avons de l'humanité et de la prudence.
Et Cascaret conclut avec une gracieuse liberté d'esprit :
— Je vous ai développé, Monsieur, tout mon gouvernement. Je l'administre avec une équité qui ferait honte à plus d'un juge du Châtelet et à plus d'un gouverneur de province. Nous vivons à la façon des bohèmes qui, sans acheter aucune chose, ont tout ce qui leur est nécessaire; nous sommes dans Paris comme des loups dans une forêt : pour ma part, toutefois, j'essaie de relever ma profession par l'espèce de vertu qu'elle peut encore comporter, et en même temps je me sens absous parles dangers qui sans cesse la menacent et qui ne sont point de ceux dont il faut rire. C'est le risque plus grand, c'est le risque de mort, qui ennoblit le métier de larron et de fille, comme le métier de monarque. Au surplus, j'ai l'honneur d'être libertin. J'ai eu jadis quelque teinture de la doctrine de M. Gassendi, mais j'en ai poussé les conséquences plus loin que n'osa faire ce galant homme. Cette philosophie convient à mon état, et mon état se trouve justifié par cette philosophie. Ne le pensez-vous pas, Monsieur ?
— Monsieur, tout, en effet, est relatif, bégaya Jean de La Fontaine.
Il approuvait tout; une ivresse indulgente noyait ses yeux. Il souriait à Quentine et à Simonette, qui peu à peu s'étaient approchées et qui lui faisaient des agaceries.
— Monsieur, dit Cascaret, si l'une de ces bonnes filles à l'heur de vous agréer... Sachez que nous sommes fort au-dessus de la jalousie vulgaire.
— Monsieur, dit Jean d'une voix empâtée, comment reconnaître ?...
— Vous en avez, Monsieur, un moyen bien simple. C'est de vous faire mon maître en poésie et de condescendre à corriger mes vers (1).
Jules Lemaître.
[Lire la suite]
____________________________________________________________________
(1). Beaucoup de détails et même de phrases de ce chapitre sont empruntés à un petit livre de 1670 : Le poète extravagant avec l’assemblée des filous et des filles de joye, nouvelle plaisante, par Oudin de Préfontaine