| Théâtre de Jean Anouilh Mis en ligne : [25-01-2009] Domaine : Lettres |  |  |
|
La Revue Critique des idées et des livres |
| "Ce n’est pas seulement pour vivre ensemble, mais pour bien vivre ensemble qu’on forme un État." aristote |
|
Politique | International | Société | Idées | Histoire | Arts | Littérature | Revue des revues
|
| Théâtre de Jean Anouilh Mis en ligne : [25-01-2009] Domaine : Lettres |  |  |
| Barbey d'Aurevilly de Michel Lécureur Mis en ligne : [28-01-2009] Domaine : Lettres | 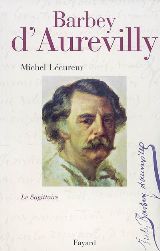 |
Michel Lécureur, Barbey d'Aurevilly, Paris, Fayard, Mai 2008, 535 pages.
| L'heure de la fermeture dans les jardins d'occident par Bruno de Cessole Mis en ligne : [25-01-2009] Domaine : Lettres |  |
| Journaux de guerre par Ernst Jünger Mis en ligne : [23-01-2009] Domaine : Lettres |  |  |
| Les pieds dans l'eau par Benoît Duteurtre Mis en ligne : [12-01-2009] Domaine : Lettres |  |
« Le 29 septembre 1990, une vingtaine de descendants de René Coty se retrouvèrent à l’Élysée. Chez les petites-filles du Président, d’ordinaire si ardentes à rompre avec le passé, l’opportunité sembla éveiller un brin d’amusement. Les années glorieuses s’éloignaient suffisamment pour prendre un arrière-goût folklorique. Tout le monde avait oublié le nom de Coty – sauf pour le confondre avec celui d’un parfumeur. L’époque présidentielle ne représentait plus une menace avec ses privilèges. Rien ne pouvait désormais entraver le triomphe de cette vie normale vers laquelle ma famille inclinait depuis trente ans. »
Avec ce roman familial, Benoît Duteurtre déploie son art d’humoriste social sur un mode plus intime. À l’ombre des falaises d’Étretat, il observe les transformations de la bourgeoisie en vacances, le catholicisme revisité par mai 68 et sa propre évolution de jeune homme moderne à la découverte de la nostalgie.
| Louvois, Ministre d'Etat par Auguste Laugel |  |
A l'issue des deux règnes de Louis XIII et de Louis XIV, la France dispose d'une administration moderne, efficace, que l'Europe entière nous envie. C'est l'œuvre d'un petit nombre d'hommes d'exception, entièrement dévoués au pays et qui servent leur souverain avec passion. Richelieu et Colbert marchent en tête de cette cohorte des grands serviteurs de l'Etat. Ils jettent, comme on le sait, les bases essentielles de l'organisation du royaume, de son développement économique et social, de son influence dans le monde. Ni l'industrie, ni la marine, ni l'organisation des colonies, ni la mise en place d'un réseau moderne d'infrastructures n'échappent à leurs soins. Mais c'est à un père et à son fils, à Michel Le Tellier et à Louvois, que la France doit son organisation militaire. Une œuvre remarquable, poursuivie dans une continuité de vues et d'actions sur près d'un demi-siècle, et qui prolongea ses effets pendant près de deux cents ans... Voilà qui devrait faire rêver beaucoup de nos politiciens d'aujourd'hui.
Lorsque François Michel Le Tellier, marquis de Louvois, rentre au Conseil du Roi en 1672, il y a déjà longtemps qu'il est en charge des questions militaires. Associé dès l'âge de 15 ans par son père, le chancelier Le Tellier, à la charge de secrétaire d'Etat à la Guerre, il exerce pleinement cette fonction depuis 1677. Travailleur infatigable, aussi bien doué dans la conception de l'action publique que dans sa mise en œuvre, jusqu'aux derniers détails, Louvois reprend à son compte les schémas imaginés par son père pour réformer l'armée d'Ancien Régime. Mais il est conscient, comme Colbert, que si la France est forte en Europe, c'est surtout par la faiblesse de ses voisins, que cette faiblesse ne durera pas, et qu'il faut donner aux réformes engagées sous Richelieu et Mazarin des dimensions beaucoup plus larges. La création d'une armée permanente, de très grande taille, capable d'intervenir sur l'ensemble de nos frontières et de prendre part à des conflits à l'échelle du continent européen, est engagée. L'infanterie est modernisée, la cavalerie et l'artillerie trouvent leur efficacité, les éléments de logistique sont mis en place. Si la hiérarchie et la discipline sont les soucis constants de Louvois, il s'attache à créer les moyens d'un contrôle efficace de l'institution militaire. Les abus sont réprimés, la culture du pillage endiguée, l'avancement fondé non plus sur l'appartenance à la noblesse mais sur l'ancienneté et sur les compétences.
Autre grand mérite de Louvois, l'homme sait s'entourer et il fait confiance. A la haute administration de la Guerre, il s'adjoint le concours de directeurs et d'intendants de choc, durs, exigeants comme lui, qui démultiplient son action et sont pour beaucoup dans la rapidité et le succès des réformes. Aux fortifications, domaine auquel il consacre tous ses efforts, il appuie complètement Vauban, suit ses conseils dans les sièges délicats, il l'aide à couvrir la France de ce réseau de forteresses et de fortifications qui sera utilisé jusqu'en 1914. A la tête des armées, il soutient, appuie ou propulse également les meilleurs, Turenne et Condé puis Créqui et Luxembourg, contribuant ainsi à ce long chapelet de victoires qui - de Sinzheim à Entzheim, de Woerden à Seneffe, de Fleurus à Fribourg et à Staffarde - forge la renommée de la nouvelle armée française.
Ces victoires bercèrent les dernières heures de Louvois qui s'éteignit en 1691, harassé, comme le disait Voltaire, par « cette ardeur indiscrète de travail qui causa sa mort ». L'armée française, forte de près de cinq cent mille hommes, était devenu entre temps la première puissance d'une Europe enfin libérée du joug des Espagnols et de la maison d'Autriche. La France respirait enfin, dans un territoire à sa mesure. L'armée de Louvois lui permit, dans le siècle qui suivit, de préserver, et d'arrondir sagement, les nouvelles frontières qu'elle venait de se donner. Puis vint le temps de la folie, de la démesure et de la sauvagerie. La Révolution, puis Bonaparte, profitèrent de l'organisation militaire que leur légua - à son corps défendant - l'Ancien régime. Cette organisation permit bien des victoires et évita bien des défaites sans empêcher pourtant le désastre final. De ce gâchis, l'armée française ne se remit jamais complètement.
Les critiques ne ménagèrent pas Louvois et il n'occupe pas la place qu'il devrait dans notre histoire. On lui impute, à raison, l'incendie du Palatinat, que les Allemands mirent beaucoup de temps à nous pardonner, jusqu'à ce qu'ils fassent bien pire. Louis XIV blâma cette violence et rabroua son ministre. Quant aux « dragonnades », on sait maintenant que, s'il en accepta l'idée, il chercha plutôt à en prévenir les excès. On a été jusqu'à dire qu'il tomba, dans ses dernières années, en disgrâce, idée peu vraisemblable puisque son fils, Barbezieux, devait assumer à sa suite, et pendant plus de dix ans, la charge de secrétaire d'Etat à la Guerre.
La Revue des deux Mondes publia en mars 1867, sous la signature du grand philosophe et historien Auguste Laugel[1], l'étude qu'on lira ci après. Histoire d'un homme d'Etat.
[1]. Antoine-Auguste Laugel, né à Strasbourg le 20 janvier 1830 et mort en 1914, est un ingénieur, administrateur, historien et philosophe français. Élève de l'École polytechnique, ingénieur des mines, il fut quelque temps secrétaire et confident du duc d'Aumale, avant d'être nommé administrateur du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée. Outre des articles dans diverses revues, telles que la Revue des Deux Mondes, où il fit notamment un compte rendu de L'Origine des espèces de Charles Darwin en 1860, et au Temps, où il assura la chronique scientifique sous le nom de Vernier, il est l'auteur de nombreuses études historiques et philosophiques.
C'est Louvois qui a fondé notre état militaire. Avant lui, sans doute, la France avait des armées, vaillantes, nationales, souvent bien commandées et maintes fois victorieuses; mais on peut dire que l'armée française n'existait pas. Depuis plus de deux cents ans, la vieille organisation féodale avait disparu sans avoir été remplacée d'une façon définitive. Charles VII avait créé la gendarmerie et les francs-archers; mais le remarquable édifice d'ordonnances élevé par les Valois pour compléter cette création s'écroula bientôt dans les guerres de religion. Le génie inventif et réparateur d'Henri IV avait exercé sur l'établissement militaire de la France la même influence salutaire que sur les autres services publics; la mort le frappa avant qu'il n'eût mis la dernière main à son œuvre : armée et règlements disparurent avec lui. Au mois de mai 1610, il avait réuni en Champagne 60000 fantassins formés en régiments compacts de 4000 hommes; son artillerie était la plus nombreuse, la plus mobile qu'on eût encore vue, sa cavalerie instruite et bien montée; les places, les frontières, étaient pourvues. Avant la fin de l'année, il ne restait plus que des squelettes de régiments, des bandes de pillards et des arsenaux vides; comme.la neige au soleil, tout avait fondu sous l'action dissolvante des intrigues et des rivalités de cour. Puis était venu Richelieu; sans rien faire de complet, il pourvut à bien des lacunes, et les réformes qu'il avait conçues furent rudement exécutées. Au milieu des échecs, des revers, des trahisons, il avait poursuivi son œuvre, essayant, brisant les généraux, les administrateurs, jusqu'à ce qu'il eût trouvé les instruments qui lui convenaient. Il marque son passage par la suppression de la charge de connétable, rouage inutile qui gênait l'omnipotence-du premier ministre, par la création des intendants de justice et de finances qui devaient représenter dans les armées l'ordre et la légalité , par de bonnes ordonnances sur la solde, la durée du service, par de sévères mesures contre les passe-volants (on a dît depuis les hommes de paille), les déserteurs, les voleurs, etc.; puis le désordre, qu'il n'avait pas entièrement étouffé, reparaît. La victoire nous resta fidèle pendant la régence si agitée d'Anne d'Autriche, car Mazarin comprenait la guerre aussi bien que la politique; mais son autorité était trop contestée pour qu'il pût bien administrer. Il n'avait pas les mains très nettes; il avait besoin des généraux et les redoutait; il les flattait et ne les voulait pas trop forts; il lui convenait de leur passer beaucoup, et un peu de confusion ne lui déplaisait pas; en somme, Mazarin ne régla rien, ne fonda rien, et sous son gouvernement les institutions militaires de Richelieu tombèrent en désuétude.
Vers 1660, les gardes du roi, les escadrons de gendarmerie, quelques régiments d'infanterie qu'on appelait les vieux, composaient les seules troupes permanentes. Les autres corps d'infanterie et de cavalerie étaient créés au commencement de chaque guerre et donnés à l'entreprise comme des espèces de concessions. Formés pour un objet spécial, destinés à servir sur certaines frontières, souvent inféodés à tel prince ou à tel général, ces régiments restaient agglomérés en armée jusqu'à ce que la fin des hostilités ou une nécessité d'économie les fît débander. Les déplacer était une grosse affaire. Lorsqu'en 1643 le duc d'Enghien parvint à conduire l'armée de Flandre en Allemagne, on lui en sut presque autant de gré que de la victoire de Rocroy ou de la prise de Thionville, et en 1647 Turenne dut charger les « Weymariens » qui étaient sous ses ordres depuis nombre d'années, pour les décider à le suivre d'Allemagne en Flandre.
Les chefs de tout rang spéculaient sans vergogne. De même que les colonels et les capitaines, les généraux étaient des entrepreneurs. A mettre sur pied un régiment, à entretenir une armée avec ce que le roi donnait, beaucoup se ruinaient, d'autres faisaient des bénéfices. Parmi ceux qui gagnaient, les plus délicats ou ceux qu'animait l'amour du bien public employaient leurs profits à bien assurer le service; le plus grand nombre mettait le gain en poche : cela s'appelait « griveler sur les gens de guerre » et personne n'y trouvait à redire. Nulle mesure régulière pour assurer les subsistances, l'habillement, ni même l'armement ; nulle garantie donnée au soldat pour le présent ou pour l'avenir : officiers, cavaliers, fantassins, gentilshommes et paysans entraient au service, en sortaient, y rentraient, le quittaient encore à peu près à leur gré ; aucune règle pour l'avancement; les attributions de chaque grade mal définies, la hiérarchie militaire à peine ébauchée, souvent des généraux commandant les uns à côté des autres sans reconnaître chef supé rieur. De là un extrême désordre, une discipline très relâchée,-de grands mécomptes dans les effectifs, sans parler des excès et des souffrances de tout genre dont les gravures de Callot et certains tableaux flamands donnent une idée saisissante.
L'artillerie, les fortifications étaient dans les mains d'entrepreneurs, d'officiers, d'ouvriers qui ne se croyaient astreints à aucun des devoirs de la profession militaire. Fallait-il faire un siège, on cherchait dans l'infanterie des capitaines, des lieutenants ayant un peu plus d'instruction ou d'aptitude; ils traçaient les attaques, aidaient les 'généraux à diriger les travaux, à placer les batteries. C'est tout au plus si; pour cette fonction spéciale, ils étaient exempts de leurs gardes ordinaires; le siège fini, lorsqu'ils n'étaient pas tués ou estropiés, ils reprenaient le service de troupe. Quelquefois, comme récompense extraordinaire, ils recevaient une compagnie dans un vieux régiment; mais un général bien en cour pouvait seul faire obtenir une pareille faveur à ceux que Vauban appelait « les martyrs de l'infanterie. » Pour unique réserve, on avait les milices communales, qui n'existaient guère plus que de nom, et « l'arrière-ban » ou levée en masse de la noblesse, dernier vestige de temps passés pour toujours; c'était pour les cas extrêmes deux ressources bien précaires, et sur lesquelles on ne faisait plus de fonds depuis longtemps. Tout, dans les armées, restait à l'état d'ébauche imparfaite; mais une des institutions de Richelieu lui survivait : la charge de secrétaire d'état de la guerre avait été conservée. Ce fut le levier dont Louvois se servit pour accomplir une véritable révolution. Il fit passer l'armée des mains des particuliers dans celles du roi. Entre le chaos qui existait avant lui et l'ordre de choses qu'il a créé, la distance était immense. Son œuvre a été durable : l'état militaire qu'il a fondé était encore debout en 1792.
Ce grand niveleur n'était pourtant pas ce qu'aux derniers temps de l'aristocratie de Rome on eût appelé un homme nouveau, et quand il se mit à l'œuvre, il n'avait ni affront à venger ni haine de caste à satisfaire. La fortune de sa famille était de fraîche date : son aïeul, un très petit bourgeois, commissaire de l'un des quartiers de Paris avait reçu de Mayenne une charge de maître des comptes pour le récompenser de son dévouement à la ligue; mais son père était secrétaire d'état, et si fort en faveur qu'en 1655 le jeune François-Michel Letellier, le futur marquis de Louvois, eut la survivance de la charge paternelle : il n'avait pas quinze ans. Il fut donc en quelque sorte élevé pour les fonctions qu'il allait remplir, et dès l'enfance il s'y prépara par énergique application. En 1662, après la disgrâce de Fouquet il obtint l'autorisation de signer comme secrétaire d'état. Dès ce moment, le vieux Letellier se retire peu à peu, abandonnant à son fils les affaires de la guerre. De l'étude Louvois passe à l'action ; son administration commence. . Il arrivait avec des idées arrêtées et des connaissances spéciales très étendues; il n'apportait pas un système tout fait. Sans chercher à créer tout d'une pièce 1'armée, les divers services, il se met à modifier, supprimer, réglementer, au fur et à mesure des besoins qui se révélaient, essayant tous les .rouages qu'il avait sous-la main, et ne les changeant qu'après les avoir reconnus mauvais ou usés, procédant avec méthode, ayant toujours sous les yeux un but bien défini, mais sans tout détruire, pour tout réédifier à la fois.
Si on ne peut voir en lui une sorte de Sieyès militaire, on ne peut pas non plus le mettre sur la même ligne que Richelieu; ce serait faire à Louis XIV un rôle qui ne fut pas le sien. L histoire ne tient pas compte de certaines apothéoses prématurées, œuvre éphémère des flatteurs : ce nom de « grand » si souvent prodigué par les panégyristes à gages, elle ne l'a donné qu'à peu d'hommes, mais elle l'a décerné à coup sûr : la postérité a continué de dire Louis le Grand; c'est un jugement qu'on peut tenir pour définitif. Associé à la pensée de son maître, animé des mêmes passions, entraîné par les mêmes tendances, Louvois fut plus qu'un commis ; il ne fut jamais qu'un ministre. Serviteur parfois désagréable, trop souvent complaisant, sans pitié pour les fripons, sans merci pour les peuples, intègre, brutal, cruel, il établit dans l'ordre militaire la centralisation qui s'emparait de toute la France.
Son premier soin fut de faire compléter ses attributions les marchés pour le logement, les étapes, les vivres et les hôpitaux étaient dans le département du contrôleur-général; il les lui enleva. Il fit aussi concentrer dans ses mains le service des fortifications, réparti jusque-là entre les divers secrétaires d'état. Plus tard il créa le « dépôt de la guerre » et dans l'intérêt de sa propre gloire jamais son goût pour l'ordre et la méthode ne l'a mieux inspiré. S'il n'avait pas prescrit de conserver et de classer l'amas de dépêches et de minutes qui s'accumulaient autour de lui, nous n'aurions pas l'excellent livre que M. Rousset lui a consacré, et qui nous a si bien fait connaître .l'homme et son œuvre. Deux directeurs-généraux, Saint-Pouange et Chamlay, se partagèrent les détails de l'administration, du personnel et des opérations militaires. La confusion qui existait entre les diverses branches de la profession cessa, et on peut dire que pour la première fois le principe de là division du travail fut appliqué à la guerre. L'artillerie eut ses troupes, et les lieutenants du .grand-maître devinrent des officiers; les ingénieurs furent organisés. Avec ou sans titre spécial, chaque arme eut ses inspecteurs-généraux, qui établissaient, maintenaient l'uniformité dans le service et dans l'instruction : Martinet pour l'infanterie, Fourille pour la cavalerie, Dumetz pour l'artillerie, et pour les fortifications celui dont nos lecteurs ont déjà prononcé le nom, celui-dont l'amitié, comme l'a très bien dit M. Rousset, protège la mémoire de Louvois, l'homme de génie, l'homme de bien par excellence, Vauban.
La discipline s'exerça à tous les degrés de la hiérarchie militaire; non-seulement les déserteurs, les passe-volants et autres coupables obscurs furent poursuivis avec une rigueur que la nouvelle organisation rendait plus efficace, mais les hauts grades mêmes furent soumis à des règles qui étaient jusqu'alors .inconnues, et que de tout temps .il est fort difficile de maintenir. Si plusieurs maréchaux étaient présents dans une même armée, ils étaient obligés d'obéir à celui que le roi avait désigné; d'éclatantes disgrâces servirent d'exemple aux récalcitrants. Les officiers-généraux avançaient selon l'ordre du tableau, ils roulaient entre eux pour le service. Quiconque a ouvert un volume de Saint-Simon se rappelle toutes les lamentations que de telles mesures arrachent à l'orgueil du.duc et pair. Tout en faisant la part des préjugés et des rancunes du grand seigneur mécontent, il faut reconnaître que ses critiques n'étaient pas sans fondement; commode-pour le pouvoir qui se trouvait délivré de beaucoup d'obsessions et d'embarras, ce système avait de graves inconvénients pratiques : il était favorable aux médiocrités; la responsabilité était divisée, le commandement instable; on avait mis un terme au désordre, mais en dépassant le but. Les colonels-généraux furent supprimés ou dépouillés de prérogatives devenues exorbitantes; il n'y eut plus d'officiers nommés sans l'attache du roi; tous se trouvaient sous la surveillance du ministre; ils avaient leurs notes, leur dossiers; ils étaient protégés contre les caprices de leurs chefs, et les actes de prévarication ou d'oppression dont ils se rendaient coupables envers leurs soldats étaient sévèrement punis. Une fois la hache mise en plein bois, il semble que Louvois eût dû frapper plus ferme, supprimer la vénalité des grades; il la laissa subsister, se bornant à taxer les charges, à exiger certaines conditions d'admission; il eût voulu ouvrir la porte, des: honneurs militaires à la bourgeoisie aisée et la fermer aux nobles trop ignorants. Il essaya même d une institution qui aurait joué le rôle de nos écoles militaires, et il créa des compagnies de cadets, dont il rendit l'accès facile. On y apprenait les détails du métier, les manœuvres, les mathématiques. Le temps manqua au ministre pour développer cette idée et en soigner l'exécution, les résultats furent nuls et les compagnies licenciées; mais une sorte de noviciat fut imposée à quiconque voulait devenir colonel, et la naissance n'en exemptait personne : .pour parvenir à ce grade, il fallait avoir servi au moins deux ans dans un des corps qui étaient présentés comme des types et dont le roi s'était réservé le commandement direct, - le régiment d'infanterie qui portait son nom, et sa maison militaire.
La transformation de la maison du roi est l'une des conceptions les plus ingénieuses de Louvois. Cette troupe n'était pas réduite à de simples devoirs d'escorte et d'antichambre ; elle fut portée à 4000 hommes environ, alors que 800, malgré le luxe de la cour, suffisaient à la garde du souverain. C'était à la fois une cavalerie, d'élite, une pépinière d'officiers et une institution qui remplaçait les derniers débris de l'organisation féodale. L'arrière-ban avait été réuni une seule fois sous Louis XIV, et semblait n'avoir été appelé que pour faire constater son impuissance. On vit une sorte de cohue mal montée, à peine armée, incapable d'obéir ou de combattre, et qu'il fallut bien vite licencier. Dans l'ordre militaire, ce fut la fin de l'ancien régime, et pour lui donner le coup de grâce Louvois remplaça l'obligation du service, base et seule justification des privilèges nobiliaires, par une mesure fiscale, par une sorte d'exonération. A ceux qui préféraient payer de leur sang, la maison du roi fut ouverte : ils se firent mousquetaires, gardes-du -corps, gendarmes. On n'était pas bien sévère sur les preuves à fournir pour l'admission dans ces corps, dont l'un même, celui des grenadiers à cheval, se composait d'anciens soldats ; patriciens et plébéiens y étaient unis par une confraternité d'armes complète et touchante. La maison du roi ne conserva pas tous les caractères que Louvois avait voulu lui donner; mais jusqu'à la fin de sa carrière elle se signala par tous les genres de courage. Les mêmes brillants jeunes gens qui avaient enlevé Valenciennes en plein jour par un trait d'audace inouï gardaient leur poste à Senef avec le stoïcisme des guerriers les plus éprouvé s. « O l'insolente nation ! » s'écriait le prince d'Orange en voyant à Neerwinde la ligne des escadrons rouges et bleus onduler sous les boulets qui la frappaient et serrer ses rangs sans reculer. A Steenkerke, les mêmes compagnies décidèrent la bataille, et quand vinrent les mauvais jours, à Malplaquet, elles traversèrent dans une charge les trois lignes de l'ennemi. La dernière victoire éclatante de la vieille monarchie fut aussi leur dernier fait d'armes; ce furent elles qui à Fontenoy se jetèrent dans la brèche ouverte par les canons de Lally et culbutèrent la grosse colonne du duc de Cumberland.
Si la maison du roi donnait à la cavalerie de ligne une réserve efficace, il manquait une cavalerie légère nationale. Louvois la trouva dans les dragons, auxquels il joignit des brigades munies d'armes rayées. Nos dragons-et nos carabiniers d'aujourd'hui auraient peine .à se reconnaître dans leurs ancêtres militaires. Là proportion des troupes à cheval, quoique considérable encore, fut diminuée : en 1678, sur un exécutif d'environ 280,000 hommes, on comptait 50,000 cavaliers et 10,000 dragons. Le rôle-de l'infanterie grandissait toujours, et c'était elle surtout que Louis XIV et son ministre voulaient non-seulement augmenter, mais relever, améliorer. Le roi avait tenu à s'inscrire sur la liste des colonels; son régiment, nous l'avons dit, et celui des gardes-françaises devaient servir de modèles pour l'instruction, pour le service; ils avaient plusieurs bataillons, et leurs compagnies étaient fortes. Les circonstances ne permirent pas d'appliquer ces deux principes d'une manière générale : les régiments restèrent à un bataillon avec des compagnies assez faibles; mais ils devinrent permanents, astreints à la régularité dans l'habillement, dans l'armement surtout, qui fut fort perfectionné quoique la grande réforme, l'adoption du fusil à baïonnette, n'ait été accomplie que plus tard. Les Suisses et les Allemands formaient environ le tiers de l'infanterie; mais les premiers étaient en quelque sorte incorporés dans nos rangs depuis près de deux siècles, et les seconds, habitants pour la plupart des provinces rhénanes, avaient en France les droits de régnicoles. Sauf quelques privilèges insignifiants et peu choquants alors, ni les régiments étrangers, ni même ceux du roi, des princes et des gardes, n'étaient distingués des autres corps; ils avaient les mêmes devoirs, obéissaient aux mêmes généraux. La véritable élite de l'infanterie restait dans les régiments : à la droite de chaque bataillon, on plaça les soldats les plus braves, les plus .robustes, sous les ordres d'un officier de fortune; on leur mit sur l'épaule ce morceau de laine rouge illustré depuis par tant d'actions, et qu'ils portent encore aujourd'hui; nous avions nos grenadiers.
La règle était la même pour tous, et l'action du ministre s'étendait à tous les détails de la vie intérieure des régiments. L'é tat n'en était pas encore arrivé à tout faire directement. Les chefs de corps conservaient toujours cette responsabilité qui les faisait ressembler à des entrepreneurs; mais on les soumettait à une surveillance si étroite que les bénéfices n'étaient plus possibles, et que pour les pauvres ou les négligents la ruine était à peu prés certaine : aussi se plaignait-on amèrement de la dureté du ministre. Avec les fonds que le roi faisait remettre pour la solde, quelques distributions en nature et la contribution qui, sous le nom d'ustensile, était imposée aux communautés affligées du logement des gens de guerre, les colonels, les capitaines devaient nourrir, habiller, équiper la troupe, faire le prêt tous -les dix jours. Gare à ceux qui se permettaient des retenues illégales, qui, aux jours des revues, se passaient des hommes ou des armes pour dissimuler la faiblesse de leur effectif ou le mauvais état de leurs compagnies ! Ce n'est pas tout; il fallait trouver les recrues. Ici Louvois n'était pas gênant; pour l'enrôlement, les officiers pouvaient à peu près impunément se permettre les violences et les supercheries. Une fois les prétendus volontaires amenés sous le drapeau, ils devaient y rester quatre ans. Nulle prescription pour la taille; i1 suffisait de ne présenter « ni gueux, ni enfants, ni contrefaits. » Plus tard, on devint encore plus facile; il fallut arriver aux bataillons de salades, aux levées d'enfants de pauvres petits misérables; il fallut moissonner les générations en herbe. Louvois lui-même vécut assez pour constater l'insuffisance du racolage; il n'avait d'abord tenu aucun .compte de l'antique institution des milices, qu'il trouvait mal dé finie, qu'il considérait comme oubliée et mettait à peu près sur la même ligne que l'arrière-ban. Aussi avait-il accepté volontiers l'argent que les états de Languedoc et autres avaient offert au lieu de contingent; mais quand la guerre fut partout, au midi comme au nord, les hommes et les cadres manquèrent à l'armée de ligne. les provinces durent fournir des régiments de milice, composés d'abord de volontaires non mariés, puis complétés par le tirage au sort, habillés, équipés par les paroisses, commandés par des gentilshommes du pays. Cela donna de 25 à 30000 hommes qui servirent surtout en Italie, et s'y comportèrent bien. Aux yeux du ministre, l'appel des milices n'avait été qu'un expédient; il est fort douteux qu'il ait jamais songé à les constituer définitivement, à y chercher les éléments d'une transformation de notre état militaire; mais, quels que fussent ses projets, le temps lui manqua pour les exécuter : il mourut presque au moment où Catinat menait pour la première fois au feu les régiments provinciaux.
Si, malgré son énergie et son audace, Louvois paraît avoir hésité à compléter son œuvre par certaines mesures radicales, il ne connut pas d'obstacles dans l'impulsion donnée à deux services qui entre ses mains semblaient se confondre, la haute administration de la guerre et les fortifications. Avec les conseils et le concours de Vauban, avec l'aide de quelques intendants actifs, ingénieux, vigilants, sans pitié comme lui, les Robert, les Jacques, les Berthelet, il ne se contenta pas de réformer, il créa. Les provinces frontières, les anciennes et nouvelles conquêtes se couvrirent de citadelles, de magasins, de casernes, d'hôpitaux; leurs ressources en numéraire, en subsistances, en matériel de tout genre, étaient exploitées avec cruauté parfois, avec dureté le plus souvent, toujours avec promptitude et méthode. Chaque pays où entraient nos colonnes était aussitôt saisi par l'ingénieur et par le munitionnaire; les vivres étaient absorbés, accumulés; de vieilles murailles étaient renversées d'autres s'élevaient. Le fléau de la guerre semblait plus lourd aux peuples; si les maux quelle entraîne n'étaient pas partout aggravés, on en sentait le poids plus constamment, plus uniment. La condition du soldat fut améliorée; on songeait à le nourrir, à le vêtir, à le mettre à couvert; c'était chose neuve. Cependant l'augmentation du nombre, l'agglomération des hommes ramenaient une partie des souffrances que la prévoyance avait atténuées ; les rapports des inspecteurs parlent sans cesse de soldats « demi-nus, sans bottes, logés comme des porcs, hâves et maigres à faire peur; » mais il y avait progrès, car on constatait le mal, on y cherchait remède. N'oublions pas à ce propos que Louis XIV et Louvois arrachèrent les guerriers infirmes ou estropiés à la misère, et leur ouvrirent l'hôtel des Invalides. Quant aux opérations militaires, elles trouvèrent de nombreux points d'appui, des bases solides, des dépôts bien pourvus; elles acquirent une portée, une durée inconnues; on put menacer partout à l'entrée en campagne, choisir son point d'attaque, débuter par des coups de théâtre inattendus, avancer ou reculer sans mourir de faim, s'abriter en cas.de revers, arrêter les progrès de l'ennemi vainqueur. Nous ne possédons plus toutes les forteresses construites ou retouchées sous le règne de Louis XIV, beaucoup de celles qui nous restent n'ont plus aujourd'hui la même importance; mais soyons reconnaissants envers ceux qui ont enveloppé notre frontière de cette formidable ceinture. Non, l'argent employé par Vauban avec tant de probité et de génie n'a pas été une dépense de luxe; que ceux qui conservent, quelques doutes à cet égard relisent l'histoire-des campagnes de 1713 et de 1793 : deux fois nos places ont sauvé la France.
Nous venons de résumer en quelques pages l'œuvre accomplie pendant trente années de travail assidu; nous en avons assez dit pour faire comprendre par quels efforts on parvint à monter une première fois cette immense machine, combien les rouages en étaient compliqués, et comme tout s'y tenait. Ainsi qu'on a pu le voir, il y avait dans ce vaste ensemble quelques parties déjà parfaites, d'autres seulement ébauchées, beaucoup de bons germes à développer, des mesures excessives et des lacunes importantes. Il serait superflu d'insister davantage sur les détails; mais il nous reste à indiquer aussi brièvement que possible ce que devint un pareil instrument entre les mains d'un prince et d'un ministre qui ne connaissaient pas de frein à leur volonté, quel usage et quel abus ils en firent.
Leur première entreprise importante fut la guerre de Hollande. Louvois dirigeait déjà depuis dix ans le ministère de la guerre, lorsque le 17 février 1672 il remit au roi un état détaillé dont le total montait à 91000 fantassins, 28000 cavaliers et 97 bouches à feu; c'était la situation d'une armée toute réunie, largement approvisionnée, prête à marcher et à combattre. Quelques jours plus tard, cette masse imposante était en route. Par une heureuse combinaison de l'administration et de la politique, elle trouvait ses étapes, ses magasins préparés à l'avance; jamais encore on n'avait vu un-pareil déploiement de force et d'habileté. Bientôt la Hollande,- envahie, vaincue, demande la paix, offre des conditions qui dépassent les rêves patriotiques de Henri IV ou de Richelieu-; mais le même orgueil, les mêmes passions enflamment le roi et son ministre; ils se comprirent trop bien : l'un conseilla, l'autre décida de rejeter toute proposition. C'était l'inauguration de la politique à outrance qui sous d'autres chefs devait nous être un jour si fatale. Cette fois le châtiment fut moins terrible, mais la leçon fut sévère et promptement donnée. Les Hollandais se relevèrent par un sacrifice héroïque; nos troupes, ayant à lutter contre les eaux, les hommes et les rigueurs de l'hiver, se retirèrent ruinées. L'Europe accourut au secours des opprimés aussitôt que ceux-ci eurent repoussé l'agresseur, et la France se trouva en face d'une coalition.
Elle n'était pas épuisée et fit tête à l'orage : elle fournit six campagnes, les plus belles peut-être de notre histoire, témoignage éclatant de la puissance des créations de Louvois. D'abord notre armée se concentre, se réorganise, se renforce. L'ennemi s'y méprend; il juge mal ce grand mouvement rétrograde. Les coalisés se croient déjà au cœur du royaume; déjà ils parlent d'aller traiter les dames à Versailles; ils ont une juste confiance dans leurs troupes, dans leurs généraux, Guillaume et Montecuculli. A ces grands hommes Louis XIV oppose des .adversaires dignes d'eux, Condé et Turenne. L'un déjoue le gros dessein des alliés, tient longtemps le prince d'Orange en échec par la force d'une position bien choisie, puis le « prend en flagrant délit, » et le paralyse par la sanglante bataille de Senef. L'autre, opposé à l'un des plus froids calculateurs, à un des hommes les plus subtils qu'ait produits l'Italie, évente toutes les ruses, déjoue tous les pièges; prudent par tempérament et devenu audacieux par réflexion, il marche sans cesse, passant, repassant le Rhin et les Vosges, se couvrant tantôt du fleuve et tantôt des montagnes, gagnant bataille sur bataille et combat sur combat, Sinzheim, Entzheim, Mulhouse, Turckheim ! Puis, quand ces deux héros disparurent de là scène du monde, Turenne pour descendre dans le caveau de Saint-Denis, Condé pour s'enfermer dans la retraite, Créqui et Luxembourg succédèrent à leurs maîtres, marchèrent sur leurs traces, mais sans rencontrer les mêmes difficultés. Les alliés étaient devenus plus modestes; ils étaient passés à la défensive. Louis XIV prenait beaucoup de villes, c'était devenu le grand objet de la guerre; la paix, é tait dans l'air, il fallait pouvoir négocier pièces en main, travailler à faire le « pré carré ». Les hommes, les moyens ne manquaient ni aux ingénieurs ni aux généraux; l'effectif en 1678 avait atteint le chiffre de 280000 hommes; aucune place ne résistait à Vauban, et celles qu'il avait retouchées devenaient à peu près imprenables. Tout justifiait les prévisions de Louvois. Notre cavalerie, qui avait eu quelque appréhension des cuirassiers de l'empereur, les chargeait maintenant partout où elle les rencontrait. Notre infanterie n'avait pas d'égale : surprise à Saint-Denis, près de Mons, écrasée par le nombre, elle soutint et rétablit le combat par sa solidité. Cette sombre bataille fut le dernier épisode de la guerre : elle fut livrée entre deux généraux qui avaient en poche la nouvelle de la paix, engagée par Guillaume avec la haine-sauvage qu'il portait aux Français, acceptée par Luxembourg avec la légèreté cruelle qui ternissait alors ses .brillantes qualités. Il eût suffi d'envoyer un trompette avec un mouchoir blanc pour sauver la vie à cinq ou six mille hommes.
Ce n'était pas l'humanité qu'on apprenait à l'école de Louvois, non qu'il eût inventé ces effroyables dévastations au souvenir desquelles on a rattaché son nom : le « dégât » comme on disait, était depuis longtemps dans la pratique de la guerre, et l'incendie du Palatinat ne dépasse pas en horreur le ravage que l'armée de Galas avait fait en Bourgogne pendant l'invasion de 1636; mais le ministre de Louis XIV avait introduit dans la destruction la méthode qu'il apportait partout. Il en fit une mesure administrative, et les intendants, trouvant aussi naturel de ruiner un pays que de nourrir un régiment, apportaient indistinctement le même zèle à l'exécution d'ordres barbares qu'à l'accomplissement de leurs fonctions habituelles. Les généraux bons vivants, comme Luxembourg, riaient volontiers de la brûlerie; les hommes graves, comme Turenne, comme le vertueux Catinat lui-même, laissaient faire sans mot dire; un seul, à son éternel honneur, protesta, ce fut Condé. Il y avait, quelques malheureuses contrées comme le Palatinat, le Waez, le Brisgaw, sur lesquelles on s'acharnait particulièrement, et Louvois se complaisait dans le spectacle de ces œuvres effroyables. Deux mois avant la paix de Nimègue, au retour d'un voyage par-delà le Rhin, il mandait à son père avec une sorte de joie féroce : « Rien n'est égal à la ruine de ce pays que le roi rend à l'empereur, c est entièrement désert et en friche. De dix villages, à peine y en a-t-il deux où il y ait une ou deux maisons habitées. » Hélas ! Ce n'était pas seulement contre lui que Louvois par de tels actes soulevait de justes malédictions, il semait en Europe la haine du nom français.
Aux cruautés de la guerre succédèrent les violences de la paix. Ce que notre gouvernement n'avait pu obtenir par le traité de Nimègue, il le reprit par les «réunions» les « exécutions pacifiques»; l'on dirait aujourd'hui « annexions, exécutions fédérales, saisies de gages matériels. » C'est ainsi que Louvois s'empara de Strasbourg (Dieu l'absolve pour cette fois!), de Casal, de Luxembourg, etc. Une des raisons qui le portaient à multiplier ces occupations définitives où -temporaires, c'était la nécessité de subvenir à ce que, déjà alors, avec le seul mot « budget » de moins, on appelait « l'extraordinaire; » on n'avait pas encore trouvé le moyen de couvrir les dépenses militaires à coups d'emprunts, le grand art était de les faire supporter à l'ennemi, au moins à l'étranger. Mais sans rien désorganiser, tout en conservant même les moyens d'exécuter les prétendus arrêts du parlement de Metz et du conseil souverain de Brisach, on aurait pu diminuer les charges, réduire l'effectif. A quoi donc étaient employées tant de troupes? Au détournement de la rivière d'Eure et aux dragonnades.
Jusqu'à quel point, des hommes levés ou enrôlés pour faire le métier de soldat peuvent-ils être employés à d'autres travaux que ceux qui font rigoureusement partie du métier de soldat? En ce qui regarde même les fortifications, les routes stratégiques, quelle est la limite, durant la paix surtout ? C'est un problème difficile à résoudre. Si du moins le travail procure à la troupe une paie plus forte, une nourriture plus abondante, une augmentation de vigueur et de bien-être, on peut ne pas trop approfondir la question et' se montrer coulant sur le principe; mais, lorsqu'on voit toute une armée retenue pendant deux ans dans les marais où la fièvre la décime pour faire marcher des jets d'eau, on se croit ramené au temps des Pharaons. Quant aux dragonnades, ce mot seul en revenant sous la plume réveille l'indignation qu'on croyait avoir épuisée. Il nous faut bien en parler. Par une détestable confusion d'attributions, Louvois avait fait réunir les affaires des réformés- au ministère de la guerre, et nous devons rappeler quelles furent, au point de vue militaire, les conséquences de la révocation de l'édit de Nantes. Elle fit passer à l'ennemi 8 ou 9000 de nos meilleurs matelots, 5 ou 6000 bons officiers, 19 ou 20000 de nos soldats les plus aguerris. Ce n'est pas tout : les régiments disséminés pour convertir et châtier les religionnaires ne furent bientôt plus que des bandes. Ici Louvois est sans excuse : dé gagé de tout zèle religieux, de toute ardeur de prosélytisme, animé de la seule rage du despotisme, il fut un instigateur pressant, un instrument passionné; il conseilla la mesure, fournit les moyens, inventa la déportation, les persécutions militaires, et ce grand disciplinaire s'oubliait au point de recommander « qu'on fit faire aux soldats le plus de désordre possible. »
C'est avec les malingres tirés du camp de Maintenon, avec les pillards ramenés du Poitou et du Languedoc, qu'il fallut faire face à une nouvelle coalition, fruit de notre politique insolente, combattre sur le Rhin, en Flandre, en Italie, en Irlande (l688). Les chefs demandaient ce qu'ils pouvaient faire avec ces troupes « qui fondraient à la première fatigue. » Le ministre ne tenait pas compte de leurs observations. Il ne voulait pas s'apercevoir qu'il avait miné lui-même l'édifice élevé de ses mains;- d'ailleurs il espérait inaugurer un nouveau genre de guerre, sans hasards, sans batailles, sans marches rapides, où l'on n'aurait vu que des campements marqués d'avance, des sièges calculés à heure fixe, des bombarderies et des dévastations. Il se laissait aller à une confiance sans bornes dans les vertus de la centralisation, qu'il avait assurément bien fait d'appliquer aux affaires militaires (car là du moins personne ne peut la blâmer), mais que là même il avait fini par exagérer. Le contact des généraux dignes de ce nom lui avait toujours é té insupportable; il ne s'était pas contenté de les soumettre, il avait voulu les annuler, et s'indignait de leur opposition aux rapports directs qu'il voulait établir avec leurs subalternes, de leur résistance aux pouvoirs illimités dont il armait les intendants. Délivré de Turenne par un boulet, de Condé par la goutte, il avait vu les portes de la Bastille se fermer sur Luxembourg, qui avait conservé certaines allures indépendantes, justifiées par sa naissance et ses talents; Créqui, avec qui il fallait aussi compter, venait de mourir. Louvois ne songeait pas à les remplacer sérieusement; l'infatuation, le goût des hommes .commodes, ces deux vers rongeurs du despotisme, égaraient son jugement. Avec des tacticiens de cabinet, des ingénieurs, des munitionnaires, des généraux porte-voix à la tête des troupes, il croyait suffire à tout. 'Une expérience de deux ans lui apprit la vérité de cet axiome bien connu, que les plans de campagne ne valent que par l'exécution. Tout alla mal. Notre prestige nous protégeait encore, quelques faits d'armes consolaient notre amour-propre; mais nous reculions partout, notre péril grossissait chaque jour avec le nombre de nos ennemis, augmenté par des alliances nouvelles et par la fureur des populations, qui couraient aux armes pour se venger de nos incendies et de nos ravages. Il fallut pressurer le royaume, redoubler de violence pour trouver des hommes et de l'argent; il fallut enfin remettre Luxembourg à cheval, il fallut remercier la bonne étoile du ministre qui lui avait amené Catinat sous la main.
Librement, audacieusement interprétées par ces deux capitaines illustres, au lieu d'être prises au pied de la lettre par MM. d'Humières, de Lorges ou de Duras, les instructions parties de Versailles donnèrent d'autres résultats : Staffarde et Fleurus, noms chers à la France furent ajoutés à la liste de nos victoires (1690). Ce furent les dernières joies de Louvois. Il mourut l'année suivante écrasé par le travail, par les soucis, par le poids d'une responsabilité énorme. On ne lui épargna pas la haine, et il la méritait, car il avait infligé de grands maux; mais les clameurs dont le concert poursuit encore sa mémoire ne sont pas toutes de bon aloi : aux cris de douleur des huguenots déportés, des peuples foulés, des provinces dévastées se mêlent les calomnies des intrigants évincés, des grands seigneurs froissés, des fripons pourchassés. Il fut aussi regretté, car il n'eut que des successeurs médiocres, et l'on se figurait que s'il eût vécu, bien des calamités eussent été épargnées à la nation. Plus que personne cependant il avait contribué aux malheurs du règne. Il avait compromis par sa politique intérieure et extérieure les résultats de son administration. En poursuivant la chimère de l'unité religieuse, il avait troublé l'union de la patrie. Bien plus que l'engouement jacobite, bien plus que la querelle de la succession d'Espagne, ses usurpations et le mépris qu'il affichait de tous les droits avaient soulevé l'Europe contre nous, et si Louis XIV, vieillissant, employa des « généraux de goût, de fantaisie, de faveur, » s'il se laissa prendre trop souvent à « l'air admirant, rampant, plus que tout à l'air dû néant devant lui, » ce fut la conséquence des habitudes créées par son ministre d'état. Le despotisme étouffant, partout introduit, avait abaissé le niveau des hommes, brisé les ressorts individuels; mais au milieu de tant d'erreurs Michel Letellier avait donné à l'armée une si forte charpenter, il avait entouré notre frontière factice d'une si solide barrière, que la fureur de nos ennemis se brisa contre la résistance de la France. Les institutions de Louvois ont donné à Louis XIV et à Villars le moyen de repousser l'invasion. C'est ce que nous ne pouvons oublier.
| Beautés de l'Astrée par Pierre Gilbert |  |
La littérature précieuse reviendrait-elle à la mode ? Elle inspire à nouveau, en tout cas, des créateurs et des œuvres de qualité. Eric Rohmer lança, il y a deux ans, le mouvement avec ses Amours d'Astrée et de Céladon - film librement inspiré de l'œuvre d'Urfé, qui connut un succès plus qu'honorable. Un autre cinéaste, Christophe Honoré nous a régalés, l'an dernier, d'une Belle Personne, qui transposait à notre époque, avec légèreté et justesse, l'illustre roman de Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves. Un public plus averti trouvait dans les meilleures librairies en février dernier une réédition parfaite des œuvres du Chevalier de Méré[1]. Quant aux amateurs de musique, l'ensemble Faenza les comblaient avec un recueil d'airs anciens du temps de l'Astrée[2], du meilleur goût. Après tant d'années d'indifférence et d'oubli, les sectateurs de Voiture et de Benserade ne pouvaient être que satisfaits[3].
Rien n'était moins évident que ce retour en grâce de la préciosité. Molière a su si bien en brocarder les excès qu'elle a gardé chez nous mauvaise réputation. Et pourtant comment ne pas voir qu'elle est un trait constant des lettres et de l'esprit français. Les sommes romanesques du Moyen-Age, imprégnées d'amour courtois, en forment les prémices ; la préciosité avant l'heure, c'est aussi Marot, Maurice de Scève sous la belle influence de Pétrarque, puis nos jumeaux de la Pléiade, le du Bellay des Regrets et des Antiquités de Rome, le Ronsard des Amours. Mais avec la marquise de Rambouillet, Voiture, Malleville et Mademoiselle de Scudéry, c'est tout un monde d'élégance, de pureté du langage et de dignité des mœurs qui se forme. On y fait des vers, on y lit la comédie ou les romans à la mode. Et surtout, on y parle et d'abord de l'amour, qui est au centre de toutes les conversations.
Bien sûr, ce goût pour la préciosité ne touche pas seulement la France : en Espagne et en Italie aussi, on fait salons et nos précieux savent ce qu'ils doivent au Cavalier Marin, à Cervantès ou à Luis de Gongora. Mais la puissance d'assimilation, d'absorption de la langue française joue, une fois encore, son rôle, et ce qui n'est ailleurs qu'un moment ou qu'une mode imprime une direction durable à notre création littéraire. Molière, Racine, La Fontaine ou La Rochefoucauld sont encore tout imprégnés de la préciosité. On la retrouve aussi bien chez Marivaux, Bernardin de Saint Pierre ou Florian un siècle plus tard, et, plus proche de nous, Stendhal, le meilleur Verlaine, le Parnasse tout entier, puis Boylesve, puis Proust, puis Giraudoux en portent dignement l'étendard[4].
Mais c'est incontestablement Honoré d'Urfé qui cristallise le mieux l'esprit précieux. Sa vie vaut à elle seule plus qu'un roman. Aventurier, il participe à tous les désordres de son époque troublée ; il prend le parti de la Ligue auprès du duc de Nemours et combat pendant plus de dix ans les troupes royales ; l'exil l'amène au service du duc de Savoie, dont il est un des capitaines et c'est au cours d'une des campagnes glorieuses des savoyards contre la République de Gênes qu'il trouve la mort. Poète, il est l'homme d'une œuvre presque unique et inachevée, l'Astrée, roman sentimental et paisible, dont l'atmosphère tranche en tous points avec la vie de l'homme de guerre ; sur les bords du Lignon, dans ce Forez qui fut la patrie d'Honoré d'Urfé, ses bergers et ses bergères dissertent à l'infini, sous le prétexte d'intrigues aussi charmantes qu'improbables, de l'amour idéal et de la vie des amants parfaits. D'Urfé fut d'ailleurs aussi de ceux-là et sa passion mélancolique pour sa belle-sœur, Diane de Chateaumorand, fut sans doute pour beaucoup dans sa réputation. On sait que cet amour fut deux fois malheureux.
C'est cette histoire d'amour et d'aventure que nous raconte ici Pierre Gilbert. Cet article, publié en 1913 par la Revue Critique des Idées et des Livres[5], n'a pas pris une ride et on y retrouve l'intelligence, le goût, l'ironie, mais aussi la bonté de son jeune auteur. Eternelle jeunesse de l'amour courtois.
[1]. Antoine Gombaud, Chevalier de Méré, Œuvres complètes, présentées par Patrick Dandrey, Klincksieck, février 2008.
[2]. Ensemble Faenza, dirigé par Marco Horvat, L'Astrée. Musiques d'après le roman d'Honoré d'Urfé, Editions Alpha, Septembre 2008.
[3]. En affichant ouvertement son ignorance pour l'œuvre de Mme de Lafayette, le chef de l'Etat lui rendit, sans le vouloir, un bel hommage ainsi qu'à toute la littérature précieuse.
[4] Sans oublier la jeune cohorte des poètes de la renaissance française qui firent, pour la plupart, leurs premières armes dans cette revue de 1908 à 1924 : Jean-Marc Bernard, Lionel des Rieux, Eugène Marsan, Tristan Dérème, Tristan Klingsor, Jean-Louis Vaudoyer, François-Paul Alibert... Aucun d'entre eux qui n'ait été touché par la grâce de la préciosité.
[5] La Revue Critique des Idées et des Livres, 10 Avril 1913.
Honoré d'Urfé dépassait à peine ses vingt ans quand il conçut pour Mlle de Chateaumorand une passion désespérée. Quel espoir eût-il gardé, puisque sa famille le destinait à l'ordre de Malte et bientôt le mit en route ?
Pendant son absence, d'ingénieux parents, aussi aveugles que charitables, s'avisèrent qu'un mariage réconcilierait les deux puissantes familles ennemies de Chateaumorand et d'Urfé. Funeste calcul. De retour après quelques années, le jeune d'Urfé retrouvant sa maîtresse épouse de son frère, s'abandonna à sa douleur et pensa en mourir. Il aima d'autant plus qu'il se savait mieux défendu et par ses vœux de chevalier de Malte et par la vertu de sa nouvelle parente. Entre eux s'établit un commerce auquel, dans le secret de son âme, le jeune chevalier prenait un plaisir merveilleux, car il lui prêtait des significations que, pour sa gloire, on pense qu'il eût rougi d'avouer. « II n'y a de toutes les flèches d'Amour, nulle plus acérée que celle de la conversation. » C'est dans ce temps qu'il éprouva la vérité de cette maxime, en se laissant cribler de si délicieuses blessures.
Il devait connaître pire cruauté, et il y eut un moment où sa position devint vraiment intolérable. Mlle de Chateaumorand ne donnait point d'enfant à son mari. Or, le bruit transpira que la cause n'en tenait qu'à lui. En effet, M. d'Urfé était dans le cas de pouvoir faire rompre son mariage canoniquement. Cette lueur d'espoir et toutes les images qu'elle réveillait brusquement, ravivèrent toutes les douleurs du jeune homme, en les mêlant de honte et de déception. Car M. d'Urfé aîné ne paraissait toujours pas disposé à aller en cour de Rome.
Enfin il s'y décida, ou bien on l'y décida. Le mariage fut annulé et l'ancien mari se retira dans un cloître. Coup de fortune inespéré qui relança le chevalier au comble de la félicité alors qu'il avait bu les amertumes injurieuses de la plus sombre destinée. Sans trop de peine, il rompit aussi les vœux qui de son côté s'opposaient au mariage et déclara sa passion. Enfin, ces amants modèles s'épousèrent, mais il fallut vaincre les frayeurs de Mlle de Chateaumorand, toute rougissante des innocentes privautés accordées naguère à un beau-frère dont elle ne soupçonnait pas la secrète ardeur.
Ce beau chapitre de roman, qui rappelle d'autant mieux la Princesse de Clèves que celle-ci naquit un peu de là, d'Urfé n'a pas omis de le placer au centre, au cœur de son Astrée, roman, dirai-je, non seulement à tiroirs, mais à clé, bien digne, par conséquent, d'intéresser les femmes, qui sont toujours ménagères. Et non content de mettre son histoire dans son livre, d'Urfé y fit aussi entrer celle de beaucoup de ses contemporains. Après cela, on s'é tonnerait qu'il y eût. réellement-dans ce roman, soutenu par une telle expérience, autant de fadeur qu'on le veut bien dire. Et la vérité est que, sous un appareil trompeur de bergerie, on sent bien de l'énergie souvent et beaucoup de vrais accents de passion, dans cette Astrée qu'on ne lit plus, mais qui a fourni de lectures et de méditations passionnées quelque dix générations.
Or, voici que M. Hugues Vaganay a eu l'ingénieuse pensée et la patience de tirer de l'interminable récit les très véritables maximes de messire Honoré d'Urfé. Et chemin faisant, il exhume de ces beautés, dont vous aurez votre part.
Il n'y a rien que les yeux qui fassent naître l'amour, ni rien qui le fasse croître davantage que de s'entrevoir souvent.
L'amour qui est couverte est beaucoup plus violente.
Il y a une certaine heure en la volonté des femmes, que si on la rencontre, on obtient tout ce qu'on leur peut demander, et, au contraire, si on la perd sans s'en servir, jamais ou pour le moins fort rarement, se peut-elle recouvrer.
C'est un des meilleurs signes qu'on puisse avoir d'être aimé d'une dame quand elle tâche de couvrir aux autres la recherche qu'elle sait bien qu'on lui fait.
La femme est fort ressemblante quelquefois à la mort, qui se donne à nous lorsque nous y pensons le moins.
Une fille un peu glorieuse est plus aimable.
Ne citerons-nous pas aussi la chanson :
Puisqu'elle était femme, il fallait bien juger
Qu'elle serait légère.
L'onde est moins agitée, et moins léger le vent,
Moins volage la flamme,
Moins prompt est le penser que l'on va concevant
Que le cœur d'une femme ?
Mais voici plus sérieux. D'abord un éloge de la réserve convenable au chagrin et à la mélancolie :
L'extrême ennui a cela, que la solitude doit être son premier appareil.
Et puis cette théorie de notre théâtre, pour ne pas dire de toute notre littérature classique:
II n'y a rien qui touche plus vivement qu'opposer l'honneur à l'amour : car toutes les raisons d'amour demeurent vaincues, et l'amour toutefois demeure toujours en la volonté le plus fort.
Enfin le petit recueil de M. Vaganay donnerait l'envie de lire L'Astrée, si la prudence ne nous l'ôtait
| Chroniques 1968
Chroniques d'Alexandre Vialatte Mis en ligne : [2-01-2009] Domaine : Lettres |  |
| Prends garde à la douceur des choses |  |
 |

|
|
Revue trimestrielle
N°1 - 2009/01 |
|
Présentation
|